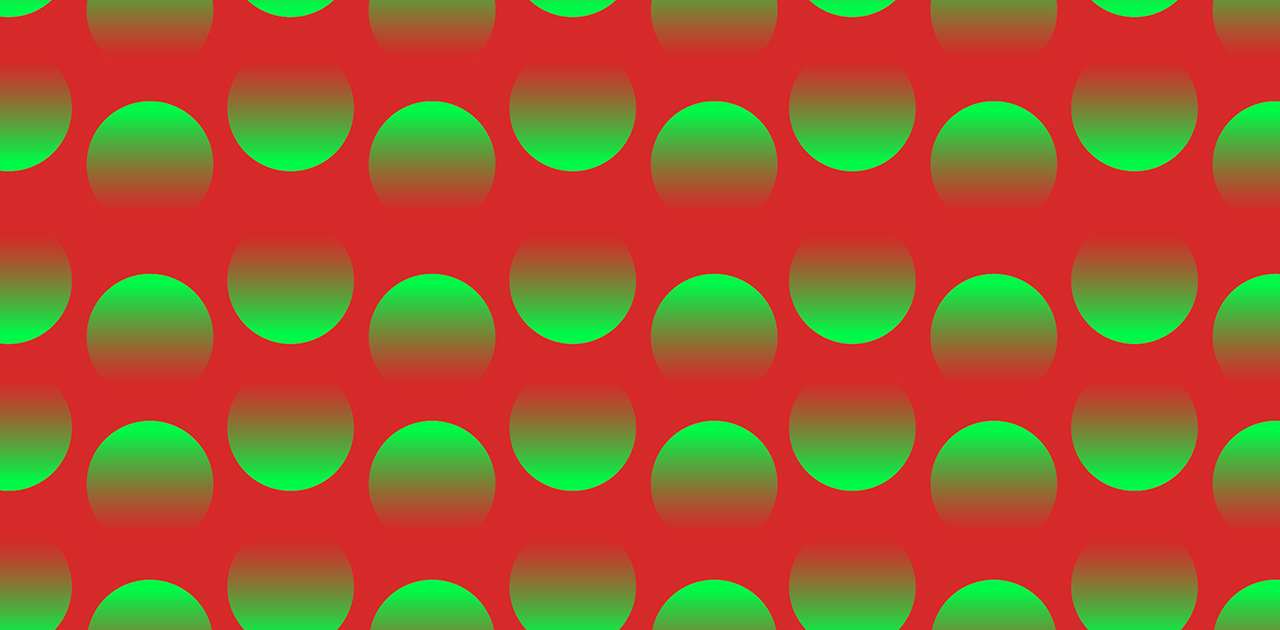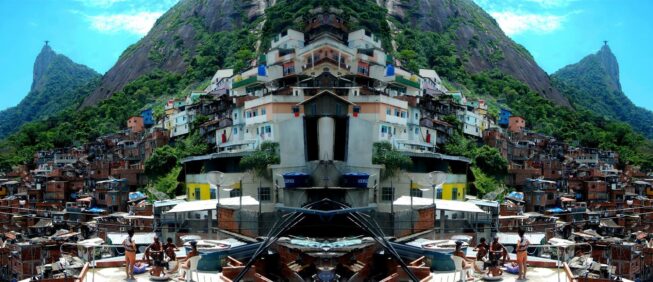Demain, le soleil
Ishmael Beah
| Sierra Leone |
15 de juin de 2023
traduit par Alice Delarbre
extrait de Demain, le soleil
(Presses de la cité, 2015)
*
C’est la fin, ou peut-être le début d’une autre histoire.
Chaque histoire commence et se termine par une femme,
une mère, une grand-mère, une fille, un enfant.
Chaque histoire est une naissance…
Elle fut la première à arriver là où le vent ne semblait plus souffler. A plusieurs kilomètres du village, les arbres s’étaient enchevêtrés. Leurs branches poussaient vers le sol, enfouissant les feuilles dans la terre afin de les rendre aveugles et d’empêcher les rayons du soleil de leur promettre des lendemains riants. Seul le chemin avait des réticences à se couvrir entièrement d’herbe, comme s’il savait que la chaleur de pieds nus ne tarderait pas à le ramener à la vie, à apaiser sa faim.
Les longs sentiers sinueux étaient comparés à des « serpents », sur lesquels on allait à la rencontre de son existence ou qui conduisaient à des lieux vivants. A l’image des reptiles, ces sentiers étaient enfin prêts à la mue, à échanger leur ancienne peau contre une nouvelle. Un tel processus prenait du temps, surtout s’il était régulièrement interrompu.
Ce jour-là, elle fut la cause d’une de ces interruptions en foulant la terre de ses pieds nus. Il est possible que ceux qui ont déjà vu passer de nombreuses saisons soient toujours les premiers à raviver la flamme éteinte de l’amitié entre l’homme et la nature. Il est tout aussi possible que ce fût le fruit du hasard.
La brise poussait son corps osseux, drapé dans un vêtement abîmé, usé et décoloré par d’innombrables lavages, vers ce qui avait été son village. Elle avait retiré ses tongs, placées en équilibre sur sa tête, et posait délicatement ses pieds nus sur le chemin, éveillant la terre séchée à chacun de ses pas légers. Les yeux fermés, elle invoqua l’odeur délicieuse des fleurs qui se transformeraient en grains de café, que le souffle discontinu du vent diffusait dans l’atmosphère. La fraîcheur de ce parfum l’emportait sur celui de la forêt et trouvait les narines des visiteurs à plusieurs kilomètres. Promesse, pour le voyageur, de présence humaine, d’un endroit où se reposer et étancher sa soif, voire de renseignements s’il était perdu. Ce jour-là, cependant, l’odeur lui tira des larmes. Silencieuses d’abord, elles devinrent des sanglots, puis un cri du passé. Un cri-complainte, qui pleurait ce qui avait été perdu et dont le souvenir subsistait, et un cri-victoire, qui célébrait le peu qui avait survécu, auquel on pourrait insuffler ce qu’il restait du savoir ancien. Elle ondulait au rythme de sa propre mélodie ; l’écho de sa voix l’emplissait, faisait trembler son corps, avant de se répandre dans la forêt. Elle poursuivit sa lamentation plusieurs kilomètres durant, arrachant quand sa force le lui permettait les plantes sur sa route et les abandonnant sur le côté.
Enfin, elle atteignit le village paisible, où elle ne fut pas plus accueillie par le chant des coqs que par les jeux des enfants, par le fracas d’un forgeron qui transformait un fer chauffé au rouge en outil que par la fumée qui s’échappait des cheminées. Malgré l’absence des signes d’une époque apparemment révolue, elle était si heureuse d’être rentrée qu’elle se surprit à courir vers sa maison, ses jambes soudain animées d’une énergie inattendue pour son âge.
La lumière produite par le feu peignait l’ombre noire de chaque villageois sur les façades alentour. Certains jeunes étaient absents, et d’autres ne cachaient pas qu’ils étaient venus à contrecœur. Les plus impatients appartenaient à la génération d’Oumu et de Thomas, qui avaient entendu parler par leurs parents de ces scènes du passé. Hawa et Maada faisaient exception parmi leur génération : malgré ce qu’ils avaient enduré, ils se réjouissaient de voir renaître la flamme d’une telle coutume. Les quelques jeunes arrivés sans leurs parents et qui passaient leur temps à errer dans le village, prêtant main-forte à droite et à gauche en échange de nourriture, restaient dans leur coin. Ils écoutèrent l’histoire d’une seule oreille, sans baisser la garde.
Peu importait la motivation des uns et des autres, tout le village était réuni autour de Mama Kadie et de ceux qui ressentiraient, à sa suite, le désir de conter. Ainsi le voulait la tradition : un des anciens, souvent une femme, racontait une histoire, puis d’autres joignaient leurs voix à la sienne. Certaines nuits, la réunion se prolongeait si tard que l’on sollicitait même les enfants, qui répétaient les récits entendus. Ce soir-là, Mama Kadie, placée au milieu du cercle, déambula autour du feu tandis qu’elle devenait conteuse, déplaçant parfois les branches pour le ranimer ou l’étouffer, selon la tonalité de sa fable. Certains des jeunes qui s’étaient installés à l’écart se rapprochèrent progressivement.
« Conte, conte, que dois-je faire de toi ? » avait-elle crié, donnant ainsi le signal du départ.Le public lui avait répondu : Elle répéta sa question un certain nombre de fois, jusqu’à ce que tous réclament son histoire.
Il était une fois un homme qui se plaignait continuellement de sa condition et critiquait tous les aspects de son existence. En particulier le fait de n’avoir qu’un seul pantalon, troué de partout. On pouvait apercevoir sa peau à travers celui-ci, si bien qu’à distance on croyait qu’il portait des carreaux. Quand il approchait, on ne pouvait s’empêcher de rire, s’émerveillant que la nature puisse jouer un tour pareil. Bientôt, tous les jeunes qui avaient des trous dans leurs pantalons se réclamèrent d’une nouvelle mode « mi-peau mi-tissu ».
Le tailleur déplorait évidemment cette mode et accusait l’homme au pantalon troué de causer sa perte. Plus personne ne venait le voir pour faire repriser ses vêtements ; la beauté naturelle était devenue le maître-mot. Le tailleur se mit à suivre l’homme partout, guettant le moment opportun pour lui voler son pantalon et le détruire. Un jour, en fin d’après-midi, alors que l’homme rentrait des champs, il décida d’aller se baigner dans la rivière. Il retira son pantalon, le lava avec soin, le mit à sécher sur l’herbe et s’immergea entièrement dans l’eau. Le tailleur, caché jusque-là dans les fourrés, y vit une occasion à saisir. Pourtant, comme il se préparait à fondre sur le pantalon, un autre homme surgit d’un buisson et disparut avec le vêtement. Lorsque le baigneur sortit de la rivière, il n’en crut pas ses yeux. Il lança à la cantonade : « Si c’est une blague des dieux ou d’un humain, elle ne me fait pas rire. » Il attendit un moment, mais n’obtint aucune réponse. Puis il aperçut les traces de pas du voleur et partit d’un rire si énorme qu’il bascula dans l’eau. Il se débattit pour se relever, toujours hilare. « Il doit donc y avoir quelqu’un de plus malheureux que moi, dit-il, et si c’est le cas, je lui souhaite de profiter du reste de mon pantalon. Dieu et les dieux soient loués de ne pas avoir fait de moi le plus pauvre des hommes. » Il dansa dans l’herbe, sous l’œil du tailleur, furieux à l’idée que le voleur se servirait du pantalon. Il voulait voir celui-ci détruit.
Quand l’homme s’éloigna sur le chemin du village, le tailleur sortit de sa cachette. Il décida d’en profiter pour se rafraîchir et se laver. Il retira donc ses vêtements et plongea dans la rivière. Alerté par le bruit de l’eau, l’homme nu revint sur ses pas en courant, persuadé qu’il allait découvrir son voleur. Il ne vit personne. Des vêtements flambant neufs l’attendaient cependant : un pantalon et une chemise. Il observa les alentours. Le tailleur était tout au fond de la rivière pour profiter de sa fraîcheur, si bien que la surface était redevenue parfaitement lisse. L’homme se mit à danser dans sa nouvelle tenue. Cette journée était vraiment merveilleuse.
Au moment de reprendre son souffle, le tailleur constata qu’il n’avait plus rien à se mettre. Et ce fut un spectacle bien étrange que celui du tailleur courant nu à travers le village. L’assemblée était secouée de rires. Les enfants de l’âge d’Oumu s’esclaffaient sans la moindre arrière-pensée et se répétaient les meilleurs passages. L’hilarité des adultes était encore plus grande parce qu’ils savaient que l’histoire était vraie. Le tailleur était parmi eux, de même que l’homme au pantalon à carreaux. Mais qui était le voleur? Personne n’eut à se dénoncer ; ces rassemblements étaient souvent l’occasion de tirer un trait sur le passé. Lorsque le rire fut épuisé, les adultes et les anciens formèrent leur propre cercle, laissant les enfants discuter entre eux des contes. Les premiers entamèrent une conversation sérieuse. Dans le silence qui se fit, ils entendirent les rires et les bruits des enfants qui jouaient ensemble.
Si Dieu était quelque part, ce soir-là il se trouvait parmi eux.
Personne n’aurait pu prévoir que ce rassemblement serait le dernier. Les anciens auraient raconté d’autres contes s’ils avaient perçu les étranges bouleversements apportés par le vent de l’époque. Il était trop tôt pour espérer davantage, cependant. Ils avaient appelé de leurs vœux des changements progressifs et la réintroduction d’anciennes coutumes. Il leur était impossible de penser à un avenir plus lointain.
Il arrive que le sens d’un récit ne soit pas immédiat, qu’il faille, pour l’auditeur, le conserver dans son cœur, dans son sang, jusqu’au jour où il se révélera utile.

Ishmael Beah | SIERRA LEONE |
Après l’assassinat de sa famille durant la guerre civile, Beah a été recruté en tant qu’enfant soldat à l’âge de 13 ans. Grâce à l’aide de l’UNICEF, il a retrouvé le chemin de la vie civile et a étudié aux Etats-Unis. Son œuvre autobiographique, A Long Way Gone - Memoirs of a Boy Soldier (2007) est un bestseller international. Il est actuellement ambassadeur de l’UNICEF. Son troisième livre Little Family a été publié en 2020.