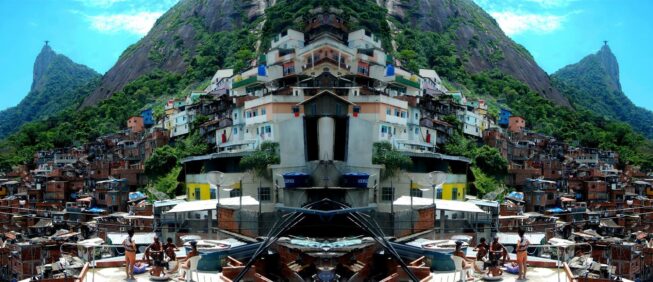Ailton Krenak - La Puissance du Sujet Collectif
Partie II
par Jailson de Souza e Silva
| Brésil |
20 de mai de 2018
traduit par Marion Mercader, Bruno Thomassin
le temps du mythe
Ailton Krenak: C’est un mythe totalement absurde de dire que nous, les indigènes, les noirs qui ont été capturé en Afrique et jeté ici, et les blancs, dont certains sont venus sans savoir où ils allaient, formons la base de notre civilisation. C’est une dévalorisation de notre histoire, un déni total des conflits qui ont marqué ces désaccords profonds entre peuples. Naturaliser les rencontres des indigènes avec les noirs dans les « quilombos » comme un événement qui apparaît comme une représentation de la force, de l’alliance naturelle de ces peuples contre l’oppresseur est un aussi une mystification, parce que quand les noirs et les indigènes ont formé des alliances dans certaines situations de « quilombo », ils ont été une si grande capacité de l’altérité, les identités ont été si claires que vous n’aviez aucun moule formatant cette idée, mettre tout le monde dans le même panier et en tirer une seule essence. Donc, les gens savaient qu’ils n’étaient pas une matière première, qu’ils étaient des êtres humains avec des biographies, des vies et des histoires. Leurs sociétés ont leurs propres trajectoires, ils avaient une alliance circonstancielle contre l’oppresseur. Mais ils n’étaient pas en train de créer une nouvelle civilisation ; cette mystification est pour nos dirigeants successifs une manière d’expliquer et justifier le genre d’histoire que nous constituons à long terme.
La meilleure façon de compléter l’histoire du Brésil d’une manière édifiante consiste à dire que même si les indigènes et les noirs continuent d’être dépouillés et mortifiés, on toujours brandit ce drapeau de l’unité brésilienne.
Même avec les blancs contrôlant par le fouet les noirs et les indigènes, ces indigènes et ces noirs étaient tellement chrétiens, tellement compatissants et fidèles qu’ils ont hissé le drapeau du Brésil, où est écrit «Ordem e Progresso». Donc, c’est un conte complètement erroné et mystificateur de notre formation.
A la base de notre formation, il n’y a que des conflits ; les blancs ne sont pas venus ici pour faire quelque chose d’édifiant, comme les noirs ne sont pas non plus venus volontairement pour être des esclaves, et les indigènes ne trouvaient pas non plus cette invasion à leur goût.
Une putain d’invasion qui ne s’arrête pas, avec de nombreux collaborateurs à l’intérieur. Quand tout le monde porte un maillot jaune et vert et se met à hurler sur l’Avenue Paulista, derrière un canard, ils nous montrent que ceux qui résistent sont en plus petit nombre que les collaborateurs. Il y a beaucoup plus de collabos qui crient: « venez nous chercher » que de personnes qui se lèvent et disent, « non, ne venez pas, parce qu’ici il y a un peuple qui vit ». Donc, ça montre encore un manque d’identité. Pour moi, c'est ce qui dénonce le plus que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour que nous puissions, un jour, nous regarder les uns les autres et dire :"D'une manière ou d'une autre, nous constituons une nation". Je ne crois toujours pas à la possibilité d'une nation brésilienne, une certaine difficulté qui m'accompagne depuis mon plus jeune âge quand j’ai décidé de ne m’engager dans aucun parti politique. Je ne me suis jamais senti appartenir à un parti politique, tout simplement parce qu’aucun d’entre eux ne me convenais.
"La meilleure façon de compléter l’histoire du Brésil d’une manière édifiante consiste à dire que même si les indigènes et les noirs continuent d’être dépouillés et mortifiés, on toujours brandit ce drapeau de l’unité brésilienne."
Et comme disait une personne rebelle de l’état de Goiás, qui m’a aidé à fonder le Centre de Recherche Indigène, quand il était en colère : « Ne me colle pas une étiquette. » C’était sa manière de se révolter. Je pense que ça a toujours été une sorte de devise pour moi, parce que l’idée réconfortante que nous sommes au sein d’une même nation ne m’a jamais emballé. Je me suis toujours senti mal à l’aise avec le sentiment que nous sommes un énorme campement dans l’obscurité, la plupart du temps nous piétinant les uns les autres. De temps en temps, il y a un éclair, et durant ce brève instant, cette illumination nous fait regarder d’un coté et puis de l’autre et dire : «Ici sont les indigènes, là les noirs, là tous les autres peuples qui sont venus ici. » Ce campement a toute cette multitude, tous ces gens et ces mondes regroupés à l’intérieur. Pendant ce bref échange de regard entre les uns et les autres, nous lançons un « Maintenant, place aux élections ! », on mène une campagne politique sur la constituante, mais ensuite on revient au campement, encore à l’obscurité et on commence le piétinement domestique. C’est seulement lorsque vous rallumez la lumière que vous vous regardez et vous vous voyez à demi dépecés, brisés.
Comment tu peux appeler ça une nation ? C’est un campement de Portugais, des vestiges, des peuples indigènes, quelques Africains et autres descendants d’Africains parce qu’il y a encore des peuples d’Afrique qui viennent ici et qui ne sont pas ramenés de force, mais ils viennent pour continuer leurs vies et leurs expériences, leurs luttes et engagements, leurs histoires et ils se redonnent du courage.
De la même manière que le peuple indigène s’encourage par le contact avec nos parents qui vivent encore dans des conditions favorables dans la forêt, ces visiteurs venus d’Afrique relancent aussi la pensée de beaucoup de penseurs noirs ici, au Brésil, sur qui nous sommes. On ne peut pas rester perdus dans un campement qui reconnaît seulement les uns les autres quand il y a un éclair, on doit être capable d’essayer une mémoire continue sur qui nous sommes.
Dans le cas des peuples indigènes, la mémoire continue doit visiter un lieu qui insistent à appeler mythe, parce qu’ils veulent la vider de son sens historique et donc l’appellent mythe.
Il arrive que ces récits mythiques annoncent des choses qu’on vit, reconnues comme histoire. L’autre jour, je me demandais quelle est le lieu que nous a prédit le mythe ? Comment une pensée s’appuie sur ce lieu du récit du mythe pour penser et interagir avec le monde ? Il m’est arrivé de dire qu’au temps du mythe, on n’avait pas cette angoisse de la certitude. On dirait un débat philosophique non ? Le temps du mythe, c’est quand vous n’êtes pas encore angoissés par la certitude. Vous n’avez pas besoin d’en être certain ; le mythe est une possibilité, et non une garantie. Il n’y a pas de garantie de durée, de temps ; il est magique. Il inaugure, ouvre des portes pour que vous traversiez et sortiez dans le monde, pour que vous interagissiez et réalisiez dans le monde. C’est toujours et obligatoirement une expérience collective. Ce n’est pas le sujet, ce n’est pas le self-made-man. Il n’y a pas de self-made-man dans cette histoire. Les gens appartiennent à des collectifs, leurs histoires sont de grandes interactions avec une constellation de personnes qui à la base même, à pour habitude d’être son héritage culturelle – ses grands-parents, ses alleux. Indépendant des cultes qu’ils suivent, à la base des mentalités, de la façon d’être dans le monde sont les mémoires les plus anciennes et les plus ancestrales.
education
Ailton Krenak : Je crois qu’on traverse et rencontre un point d’intersection intéressant avec la biographie de Macaé, dont son but est de réussir à lier ça avec l’idée de l’éducation. Son expérience avec l’éducation est une appropriation « supercritique », moins qu’un outils et plus qu’un environnement où la vie sociale du monde moderne se constitue.
C’est dans le champs de l’éducation, c’est quand tu commences à créer un sujet, à construire une personne. Dans le cas des sociétés traditionnelles d’oralité, la personne commence à être constituée bien avant le commencement, dans le rêve, avant d’être dans le ventre de sa mère. Beaucoup de ces personnes sont rêvées, et quand la mère est enceinte, la famille, le collectif savent déjà que le bébé va venir, qui est en train d’arriver. Donc, les différentes traditions savent que c’est un vieux qui est en train d’arriver. Quand le bébé naît, ils savent déjà dire en le voyant : « c’est machin et l’autre c’est truc ». Ca n’a rien avoir avec la réincarnation, ça a avoir avec beaucoup d’autres choses plus complexes. Mais c’est la capacité à comprendre le flux, la longue journée d’expérience humaine qui interagie avec ceux qui sont vivants aujourd’hui et les alleux, indépendant du culte, ils peuvent même être évangéliques. Parce que les gens peuvent dire : « Non mais ça c’est un truc de la tradition des pajés, des xamas, des candomblés ». Ce n’est pas n’importe quelle mémoire que ces gens ont, c’est la mémoire profonde, créée par ses alleux.
"Quand tu légifères la Lei das Diretrizes Basicas da Educaçao, tu signales quel type de personne tu prétends former."
Quand tu penses à une sorte de société où une action d’engagement du sujet dans la société se transmet par le processus formatif de ce que l’on peut appeler « éducation », c’est ça qui m’intéresse beaucoup, la manière dont Macaé aborde ça, par quel moyen elle le fait. C’est différent de Paulo Freire. Darcy aussi est une voie éducatrice, mais la manière dont il voit l’éducation et comment ces autres éducateurs et penseurs abordent l’éducation comme un service et une compétence de l’État, où il possède l’hégémonie d’informer ce processus et de l’organiser, de…
Jailson de Souza e Silva : Définir un programme ?
Ailton Krenak : Encore plus que de définir un programme, c’est élire la conduite que ça va engendrer. Si tu formes quelqu’un pour qu’il devienne de la main d’oeuvre de marché, si tu formes quelqu’un de critique à l’intérieur de la société que tu intégres, si tu vas former des gens pour gouverner ou être gouvernés, ça c’est un choix que l’État fait.
Quand tu légifères la Lei das Diretrizes Basicas da Educaçao, tu signales quel type de personne tu prétends former.
Macaé, son truc d’identité comme professeure, comme éducatrice, c’est sa première affirmation. Mais sa capacité à gérer son affaire, à gérer l’appareil de l’éducation et de le comprendre par l’intérieur et faire sa critique c’est pareil que critiquer la critique que je fais de l’appareil de l’État pour capturer un indigène. Je sais qu’elle a la capacité de passer au dessus de l’appareil de l’État et voir où sont les outils de la domination que l’État impose à chaque période pour produire des mentalités soumises, pour contre-produire des citoyens critiques, mais ce stock de personne que le marché demande pour les dix prochaines années. La négation de ce droit de la personne de poursuivre sa formation, sa constitution de personne critique capable d’interagir dans le monde est une des pratiques les plus constantes que l’État brésilien ait fait dans ses différentes périodes – sous Getulio Vargas, puis sous Juscelino qui s’est étendu jusqu’à la dictature qui marque une autre coupure et crée un autre type de demande. C’est comme si tu avais une ligne de production qui varie seulement en fonction de la demande. Tu programmes les machines pour produire un type de chose que le marché demande. L’éducation aujourd’hui, au Brésil, c’est décidemment pour satisfaire le marché, même quand ils avancent…
L’éducation devait être un environnement privilégié pour qu’un enfant l’expérimente. Une personne dans le monde c’est tout cette puissance, cette possibilité d’interagir avec tout. Ca ne peut pas être cet encadrement de la personne, de ce que l’on a insisté à faire. Je pense que de la même manière que je me bat dans le champs de la désorganisation de l’appareil de l’État qui est obsédé par le contrôle, Marcaé réalise ça dans le champs de l’éducation, en intervenant dans différents contextes. Je sais que pour elle, c’est difficile d’accepter une invitation pour être ministre de l’Education de l’État mais il y a une heure où notre engagement nous oblige à entrer dans une de ces ruelles et l’élargir, lui donner du sens. C’est par là qu’on doit passer. C’est dans ces circonstances qu’à un certain moment je suis resté 10 ans au sein de l’État.
Quand j’assistais l’État de Minas Gerais et pas le gouvernement de Minas, j’interférais dans les intersections de l’appareil de cet Etat, et dans sa reproduction pour contourner son contact avec nos communautés et territoires indigènes. Donc, si de l’intérieur de la machine, de l’appareil de l’État sortait les solutions pour la santé, l’assainissement, l’environnement, la gestion territoriale, vu comment ça sortait de là, ça ne pouvait pas arriver jusqu’au village parce que ça choquait. On avait qu’à scier nos dents de vampire avant de les sortir. On disait : « attends, le test du VIH n’arrivera pas comme ça dans les villages », avec le Ministre de la Santé. Ou alors « avec cette éducation, il n’y aura pas école dans les villages », ça a été le plus grand engagement de Macaé avec nous. Moduler une telle structure de réseau d’écoles de l’État qui aurait pu être instaurée dans les villages, comme elle pouvait y être instaurée. On ne pouvait arriver et faire un transfert, une extension de ce réseau d’éducation qu’il y a dehors au-delà des villages, c’était ça la tendance naturelle de l’État. Quand on a posé la question d’une éducation spécifique, d’une approche propre pour chaque ethnie, ça a été une lutte au sein de l’appareil de l’État, pour reconfigurer ce qui a ensuite donné le PIEI (Programme d’Implantation des Ecoles Indigènes). Ce programme est encore en marche aujourd’hui et lutte pour conserver son intégrité, pour qu’il ne soit pas méprisé par toutes les interférences constantes de la municipalité, de l’État et de la Superintendência de Ensino.
C’est une espèce de clapet de cinéma de l’appareil de l’État. Quand il voit surgir de la créativité, une invention en marge de la société…
Jailson de Souza e Silva : Qu’il ne contrôle pas.
Ailton Krenak : Oui, il à le droit de contrôler. Il arrête, diminue ou supprime les ressources, supprime les créateurs qui sont engagés avec celles-ci et en met d’autres à la place qui sont engagés avec eux.
florestania
Ailron Krenak :Donc, je pense que c’est une lutte continue pour agrandir l’espace de l’exercice de la citoyenneté mais une lutte qui peut atteindre l’idée inventive des peuples de la forêt qui ont assuré avoir la « florestania » (la citoyenneté de la forêt) pour opposer cette chose brute de la ville, où l’idée de citoyen est une rue étroite, de l’eau canalisée, un assainissement, un quadrillage, une copropriété, une résidence, une propriété privatisée, un service, une sécurité, la police, la santé, l’hôpital. Ils voient tout ça et disent : « Mais on représente pas ça ». Ca peut être une simplification de l’idée de citoyen, de ville mais un mouvement très actif a surgi à Rio Branco et la demande de « florestania » s’est répandue dans d’autres régions de l’Amazonie. Ce sont des personnes qui exercent la citoyenneté à l’intérieur de la forêt avec la protection des territoires, de la forêt, de la biodiversité, de la capacité du peuple à s’organiser et se déplacer dans de grands espaces qui ne sont pas des villes. C’est comme si ils questionnaient l’hégémonie des villes concernant les règlements, de communauté et il faut qu’il y ait cette résistance de la « florestania » questionnant la citoyenneté urbaine parce que la tendance de cette citoyenneté, c’est de dévorer tout ce qui l’entoure et nier la puissance des autres formes de citoyenneté.
La « florestania » est une merveilleuse manière de remettre en question les villes sont vraiment le meilleur endroit pour que les gens coopèrent entre eux, reproduisent la vie et la culture ou si elles sont seulement consommatrices d’énergie y compris de ressources naturelles parce que les villes salissent tout ce qui les entoure. Pour qu’une ville existe, elle doit construire Belo Monte, enfin c’est ce qu’ils disent.
jeunesse indigene
Jailson de Souza e Silva : C’est dans ce cadre que vous avez vu la jeunesse ? Vous avez beaucoup parlé du rôle significatif de la jeunesse dans les années 70 concernant la création du mouvement indigène. Et cette jeunesse d’aujourd’hui, comment est l’« indigène » d’aujourd’hui ? Comment vous voyez cette puissance ?
"Combien il y a t-il de protection et de ségrégarion dans l’existence d’une réserve, d’un territoire ?"
Ailton Krenak : Je vois cette jeunesse indigène allant de mon fils de 6 ans jusqu’à ceux qui ont 27, 30 ans avec une fissure dans la connexion au monde. Mais d’un autre côté, ça déconcerte une pensée conservatrice comme la mienne, mais elle anime aussi mon attente d’un prochain mouvement de leur part parce qu’eux aussi ils reconnaissent dans la forme propre de leurs grands parents et alleux, une manière légitime de résister à la fin du monde. Au plus ils se connectent, plus ils voient le monde en lambeaux. Il y a des jeunes Yawanawa qui vont en Europe, des Caxinauas qui vont en Norvège et restent 5, 6 mois là-bas en voyageant dans différentes communautés, en étant « shaman » et interagissant avec les autres, en ramenant du ayahuasca à ces peuples blancs, pour qu’ils voyagent dans le cosmos. Ils reviennent du cosmos, regardent leurs grands-parents et disent « c’est mon grand-père qui m’a appris ça », mais le grand-père de ce blanc de Norvège ne connaissait pas ça. Ca réveille un lien et créé une manière d’interagir avec l’endroit d’où ils viennent et avec les possibles autres endroits où ils peuvent être. Qui sait, ça va peut-être être une des connexions de la vie dans les villages, qui libère le peuple indigène de ce piège du ghetto. Vous ne pensez pas qu’au XXII ème siècle, il continuerait d’avoir des réserves indigènes. En Afrique, c’était appelé Banstustao, et Mandela a lutté contre ça. Il disait : « c’est de la ségrégation ».
Combien il y a t-il de protection et de ségrégarion dans l’existence d’une réserve, d’un territoire ?
Même quand ils appellent ça un territoire, ils vident le sens de sécurité que cet endroit représente pour ceux qui y vivent, le sens de contrôle de ceux qui y vivent et ils donnent peu d’information concernant la capacité que ces gens ont à interagir avec le monde. Le plus curieux, c’est qu’au même moment, au sein de l’État brésilien se conçoit une idée de réserver une terre pour les indigènes, on n’admet pas l’idée qu’ils aient un échange entre cet endroit et le reste du monde.
L’échange entre ces endroits leur enlèvent la condition d’indigène. On revient au début de notre conversation, quand les indigènes ont commencé le mouvement et qu’ils n’étaient plus considérés comme indigènes parce qu’ils n’avaient pas besoin du laissez-passer de l’administration du Gouvernement, pour circuler. Maintenant, on parle d’une circulation dans d’autres termes, qu’elle est la possibilité de circulation des idées, d’interaction de ces personnes en temps qu’indigène avec le monde. C’est dans ce programme de résidences artistiques qu’on inaugure au Xingu, qui reçoit des personnes d’Angleterre et qui emmènent leurs enfants ici, qui interagissent avec le monde. Ca ne fait pas partie de l’uniforme de la politique du Gouvernement brésilien pour les sociétés indigènes. C’est comme si le Gouvernement brésilien avait un programme pour les indigènes idéalisés mais qu’ils ne rentrent dans le moule du « vrai » indigène, ceux qui doivent manger, boire, circuler, vivre, interagir, apprendre, bouger. Donc, c’est un défi pour ces enfants qui ont de 6 à 26 ans ou même plus. C’est nous aider, aider nos parents, nos oncles et nos grands-parents à comprendre quelle est la prochaine étape à surmonter par rapport à dichotomie du monde blanc et de l’indigène. Je ne crois pas que cette condition du monde blanc et de l’indigène soit durable, on doit être capable de rompre cette frontière. Comme aujourd’hui, vous rompez cette frontière sans écraser et supprimer les différences.
Jailson de Souza e Silva: Quelle serait la position et la contribution que vous conseilleriez, quelles organisations pourraient améliorer les luttes indigènes au Brésil ?
Ailton Krenak : Pendant qu’on discutait ici, on était en train se rendre compte combien d’échange il existe déjà aujourd’hui entre le monde et les villages, dirons-nous ainsi, et les centres urbains ; autant au Brésil que en dehors du Brésil. L’appel qui se dessine pour la jeunesse, c’est d’être présent dans différentes scènes et lieux d’échanges culturels. Je pense que ce qu’on peut faire c’est peut-être d’améliorer la compréhension de la diversité des peuples que nous avons construits. Je pense que l’idée générale de l’indigène qui n’a pas de « si tu n’as pas, vas le chercher » persiste. Par exemple, on peut avoir quelques indigènes qui circulent et qui espèrent répondre à l’attente d’échange avec ce monde de la culture, dirons-nous ou de l’expérience formative, de production culturelle et qui ne s’ouvre pas à la diversité – ou mieux à la pluralité, ce sont des centaines de peuples avec des différentes matrices culturelles qui ont presque un milliard d’adresses. Quand on y réfléchit, ils doivent avoir plus de mille adresses dans les territoires indigènes au Brésil.
La tendance qui peut être réfléchie, par exemple, dans les médias – quand on regarde « telenovela » de Globo diffuse, du moins les « telenovelas » de ces 5, 6 dernières années qui ont adopté un modèle de télévision indigène. Un lieu de l’Amazonie imaginaire, ce n’est pas l’Amazonie où les riverains et les indigènes vivent tous les jours, mais une sublimation. Autant les indigènes que l’Amazonie, ils finissent par être absents, il y a peu de contact réel avec la vie de ses communautés. Je pense qu’avoir une ouverture sur cette diversité et cette pluralité peut améliorer la qualité des échanges qui apparaissent ces 5, 6 dernières années. Ce n’est pas une critique négative – péjorative – de ce qui a été fait. On a déjà réfléchi à comment on pourrait améliorer ça, je pense que c’est en diversifiant les objets d’échange. Il y a cette chose emblématique des « sertanistas ». Tu as posé la question sur les Frères Vilas Boas. Ils ont créé une école du contact, dans laquelle ils accrochaient sur un fil à étendre des casseroles, des couteaux, des accessoires et des miroirs qui attiraient les indigènes.
Ils étaient face à l’attraction qui représentait l’échange entre les blancs et les indigènes. Maintenant, on le voit aussi dans le champs des échanges culturels, où des objets sont échangés ; mais qui choisit quels sont les objets ? Se sont les blancs. Donc, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant si on ouvrait le champs des possibles des indigènes qui savent déjà faire l’énoncé de l’échange, demanderaient ce qu’ils aimeraient échanger, à l’inverse de recevoir encore une fois des couteaux, des casseroles, des miroirs. Ouvrir les espaces d’échange culturel pour qu’ils aient beaucoup plus, tu comprends ? Pas seulement plus et que ce ne soit pas à sens unique. Il doit y en avoir plein, des voies d’arrivée et de sortie. Ca peut aussi nous aider à trouver d’autres paysages, lieux d’échange – échanges effectués dans d’autres termes qui ne soient pas seulement de la capture du monde symbolique des indigènes par le monde des blancs. Comme le monde des blancs est saturé, il cherche de nouvelles références dans l’imaginaire – en Afrique, dans les forêts, dans les villages, diabolisant le monde arabe.
Donc, je pense qu’on doit rester attentif pour que ces échanges ne passent pas seulement comme une continuité de la recolonisation de nos pratiques et de nos esprits par une société avide de nouveautés qu’est la civilisation européenne, qui écarte les gens à la peau noire. Il ne faut pas forcément être blanc pour recoloniser. Il y a beaucoup de gens à la peau bronzée qui recolonisent leurs frères avec tous leurs bagages et leurs babioles occidentaux ; en capturant les univers imaginaires en échange de babioles fabriquées dans le monde occidental. C’est le cas de la marchandise. Davi Kopenawa, dans son livre « A Queda do Céu » fait la critique bouleversante de la marchandise. Il appelle les blancs de la civilisation de la marchandise. Ils disent qu’ils sont plus passionnés par la marchandise que par leurs propres femmes. Si l’un des deux se noyaient, il laisserait sa femme et sauverait la marchandise. Je trouve cette critique si horrible – ils regardent la marchandise avec plus de passion que leurs femmes. J’ai trouvé cette image si révélatrice.
democratie et mondialisation
Jailson de Souza e Silva : Quel est le défi fondamental aujourd’hui pour vous, dans une société comme la brésilienne, en crise ? Quels sont les risques de ces mouvements sociaux , que courent y compris les indigènes ? Comment peuvent-ils répondre ? Comme c’est déjà arrivé à la fin des années 70 et au début des années 80, quand vous dîtes que d’une certaine manière il sort d’un processus plus obscure et arrive à présenter des lumières communes. Quelles seraient les lumières communes en cette période de lutte pour la démocratie au Brésil ?
Ailton Krenak : Donc, on est surpris par l’idée que la démocratie ait été capturée, d’une manière aussi irréversible par l’empire. Le centre de la force obscure a capturé l’idée de la démocratie et distribue déjà la démocratie « à emporter ». Si il y avait un endroit dans le monde avec une carence de démocratie, ils créent des chaos – comme ça a eu lieu au Vénézuela – ou comme ils peuvent faire avec nous. Ou comme ils le font souvent en Argentine, ou comme ils ont fait en Syrie. Ensuite, ils y vont et plantent la démocratie. Cette idée de Printemps arabe, par exemple, qu’ils nous ont vendu, en vérité c’est ce qu’ils ont mis en œuvre dans le monde arabe – les traditions, déstabilisant, bombardant, pour ensuite venir ce discours de démocratie. J’ai un doute concernant le style de démocratie qu’ils veulent nous servir. Il est important de rester éveillé.
Cette idée « super » moderne de mondialisation, je préfère l’autre mondialisation préconisée par Milton Santos. C’en est une autre. Ce n’est pas cette connerie qu’ils créent – la mondialisation de la marchandise et l’internationalisation des ressources. C’est la mondialisation de la marchandise, de l’internationalisation des ressources, de la marchandise en circulation dans tous les sens mais des gens non. Les étrangers en Europe sont des réfugiés mais les ressources naturelles de ces mêmes peuples en Europe sont à consommer – sont les bienvenus.