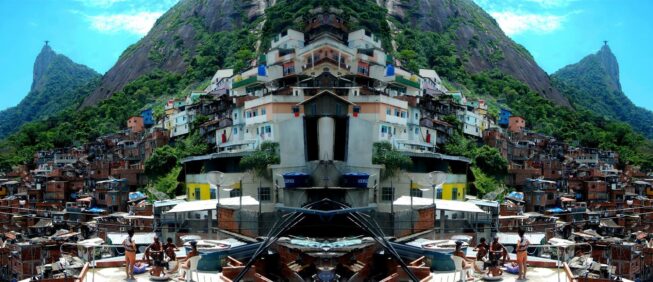Histoire Kariri : une flèche pour illuminer le cœur
Plongeon au sein des mémoires familiales d’auto-reconnaissance en tant que Kariri, une nation qui vit de l’état de Bahia à celui du Piauí
par Raquel Paris
| Brésil |
21 de août de 2020
traduit par Déborah Spatz

[Vive les caboclas1NT: le mot caboclo désigne les métisses descendants de l’union entre des européens et des indigènes du Brésil. de la forêt !
Vive Iracema ! Vive Jurema !
Vive les caboclas de la forêt Iara, Jussara, Jupira et Jandira]2Salve as caboclas da mata! Salve Iracema! Salve Jurema! Salve as caboclas da mata Iara, Jussara, Jupira e Jandira!
Ponto das caboclas - Camila Costa
Rechercher dans le passé, c’est comme compléter un album d’images autocollantes, comme on le fait quand on est enfant. Il y en a toujours une, deux ou trois qui manquent; d’autres, rares et uniques, qu’on ne parvenait jamais à trouver et qui laissaient un espace blanc quand on tournait les pages. Mais même malgré cela, on ne s’arrêtait pas, on commençait un autre album, pour réunir plus de souvenirs.
Je suis née cratense. Mon père s’appelle Francisco Alves Rocha et ma mère, Terezinha Arraes Alves Rocha. Je suis fière de dire que l’Araripe me traverse de ses côtés de l’état de Ceará et de ceux de Pernambouc. Une autre fierté, transcendantale, celle-ci, est d’être une femme du climat semi-aride. Plusieurs années plus tard, comme l’accolade d’amis très proches, j’ai reçu le nom de Paris, mon nom social, mais ça, c’est une autre histoire.
Par tous les Semi-arides brésiliens, peuples indigènes qui revendiquent leur existence face à un projet systématique d’effacementNaître dans les années 1980, dans la ville de Crato, signifiait apprendre trois choses fondamentales : d’abord, que nous devrions éviter d’être trop proche du peuple et de la ville de Juazeiro do Norte, en fin de compte, tout le monde le savait, Juazeito était la terre des ignorants et Crato, celles des illustres.
Ensuite, que sur cette terre, il n’y avait pas d’autochtones. C’était une histoire très ancienne, celle d’un peuple appelé Kariri qui avait vécu sur ces terres et qui avait été tué par les invasions du territoire. De l’eau avait coulée. Pour finir, mais non moins important, que sous l’Église de Sé, se trouve une baleine.
Aujourd’hui, je vois comment la stratégie de l’effacement de la colonialialité a fonctionné du Bangladesh à Crato. Génocider la population autochtone, tirer les narratives et la stratégies d’assimilation pour décréter la disparition corporelle et symbolique, le mort ne réclame pas la terre, après tout.
Je crois que ce qui m’a sauvé de l’effacement a été la force, l’énergie qui émane de la Chapada do Araripe, la boussole orientatrice de l’affecte et la spiritualité que je porte en moi et le Campo Alegre, la ferme au pied de la forêt dans laquelle j’ai passé mon enfance et ma jeunesse. Le lieu où j’ai appris à respecter la végétation de la caatinga, à vivre avec la sécheresse et à fêter la pluie.
J’ai reniflé que j’étais Kariri il y a peu de temps. Durant de nombreuses années, je me suis demandée à qui était affilié ce visage, cette tonalité de peau, mes cheveux épais. Où étaient les femmes qui me ressemblaient ? Où étaient les femmes qui pensaient et se sentaient comme moi ?
Doucement et de manière intuitive, je me suis interrogée moi-même ainsi que tous autour de moi. Avec ma famille, je n’ai pas réussi à aller bien loin. Malheureusement, les plus âgés, mes grands-pères, mes grands-mères et mes tantes sont déjà partis. J’ai compris que cette recherche ne se ferait pas seulement par des voies géographies, pas après ce grand incendie dévorateur de mémoires. J’avais besoin de faire confiance à mon intuition, j’avais besoin d’apprendre à être une lectrice de silences, de non-dits et d’images autocollantes qui parlent.
Ainsi, j’ai d’abord passé du temps face à un miroir, en prenant du courage et en cherchant la dignité qui m'avait été niée. Le courage de croire en ce que l’ancestralité disait à travers mon visage et ma peau. Ensuite, j’ai contemplé ma vie, mes propres souvenirs et ce que j’ai vu, ce sont les frères qui partaient chasser, une famille qui, à la saison des pluies produisait beaucoup de sa nourriture, qui s’organise de façon matriarcale et qui est dévouée à la nature et à sa protection.
Un autre élément très symptomatique : les stratégies d’effacement interne, comme le dit ma mère, à propos de mes tantes les plus âgées : « les choses se passaient et se taisaient ». Ça doit être pour cela que lorsque ma tante Cezídia m’a raconté l’origine de la famille, un ancêtre, nommé seulement « un homme brun », est apparu, un homme sans nom, sans visage qui surgit comme un nuage dans les histoires de famille.
Ces informations biaisées, libres, dites sans importance, émergent pour moi comme un symbole d’effacement dont diverses familles Kariris ont été victimes, principalement, celle qui sont restées aux abords de la ville. Des familles qui, à cause de la pauvreté obligatoire, ont souvent utilisé la négation pour diminuer le poids de la discrimination et permettre une vie moins difficile.
Ma tante Cezídia et ses sœurs Cecília et Isabel sont nées et ont vécu dans toute la ville de Crato. D’abord elles ont vécu dans la rue Pedra Lavrada, aujourd’hui appelée Pedro II. La rue Lavrada avait ce nom parce qu’elle se trouvait au bord de la rivière Granjeiro, aujourd’hui asséchée et transformée en un égout. Ensuite, elles sont allées vivre dans ce qui est aujourd’hui la rue Nelson Alencar, mais qui à l’époque, était la limite de la ville, à tel point que le cimetière se trouvait juste à côté. Mes tantes avaient pour habitude, comme le raconte mon père, de recevoir les groupes musicaux cabaçais chez elles, elles avaient des plantes et la religion comme compagnies, elles avaient pour habitude de s’asseoir par terre et de manger avec les mains. Tante Cecília et sa pipe.
Réunir ces mémoires du passé n’a pas été chose facile. J’ai dû développer une familiarité avec des concepts et des mots qui me paraissaient être des virelangues : « epistemicide », « ethnocide », mais sans eux, je n’aurais jamais compris comment la colonialité est une machine à triturer les personnes et les identités.
Je comprends aussi que, en habitant un corps féminin, traversé par la misogynie, le racisme, le patriarcat, le niveau d’insécurité, peut être paralysant dans ce processus. Beaucoup de larmes ont été versées. Je me demandais si je n’étais pas en train de tout imaginer, de tout inventer. J’ai posé des questions difficiles : est-ce que ma nécessité d’être accueillie n’était-elle pas en train de forcée une ancestralité ? C’est arrivé souvent. Mais comme le dit un bon ami : on ne peut pas passer par ce processus sans larmes. C’est dur mais, quand, enfin, nous gagnons; quand, enfin, nous nous permettons d’incorporer notre dignité et d’annoncer notre ancestralité et que nous sommes accueillies dans notre humanité et notre singularité, c’est vraiment une guérison. Une renaissance.
Chacune et chacun d’entre nous va avoir son processus. Il va utiliser ses habiletés, sa sagacité. Ce qui est le plus important, selon moi, c’est de mettre en échec le regard séparatif de la colonialité qui a l’audace de classer, de déterminer les « vrais » indigènes. Après tout, si nous nous approfondissons dans la manière dont s’est fait le processus d’invasion et d’occupation du Semi-aride brésilien, en prenant en compte le projet de génocide et d’assimilation de sa population autochtone, beaucoup de clés de perception vont commencé à apparaitre.
Des questions comme : de qui se composent la matrice ethnique du Semi-aride ? D’où viennent ceux que nous appelons les caboclos, le sertanejos, les vachers, les bienheureuses, les accoucheuses, les prieuses, celles et ceux qui ont ont rendu amère la pauvreté obligatoire dans les périphéries des villes ? De qui notre culture du Cariri et ses spécificités proviennent ?
L’histoire du Semi-aride et de ses peuples autochtones doit encore être racontée. Elle représente plus de cent ans d’effacement et de négations. Mais, pour tout ce territoire, des familles ont interrompu le silence et ont revendiqué la parole. Dona Tereza Kariri a donné son cri d’indépendance durant les années 1980 et est arrivée avec tout un cordon de Kariris, de Potiguaras, de Tabajaras. Je suis jeune dans ce périple et je t’invite à faire partie de cette ce cordon, après tout, nous ne disparaîtrons pas, nous avons toujours été là et nous ne sommes qu’au début du (re)commencement.

Raquel Paris | Brésil |
Journaliste et coordinatrice de la communication de UNIperiferias
raquel.paris@imja.org.br