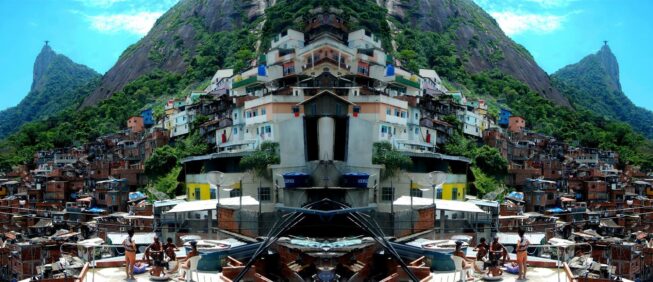Ailton Krenak - La Puissance du Sujet Collectif
Partie I
par Jailson de Souza e Silva
| Brésil |
mai 2018
traduit par Clara Dos Santos, Miguel Bustamante
Ailton Krenak n’aurait pas pu trouvé meilleur moment pour venir faire une interview publique, lorsqu’il est nécessaire d’entendre une voix qui inspire et perturbe nos perceptions pour que la lucidité et la conscience ne se dispersent plus comme le vent. C’est n’est pas une mission facile d’introduire le personnage d’Ailton Krenak. Alors que je lisais pour la première fois ces pages, j’ai entendu son récit calme balançant entre le précurseur renommé des mouvements sociaux indigènes et l’homme sincère et curieux qui partage de forme intrigante les bizarreries et les contresens du mondes des blancs. Sans aucun effort, son discours nous fait regarder de la tête aux pieds les notions déjà intégrées comme vraies. Ailton Krenak est l’un des plus grands connaisseurs de l’enchevêtrement historique de la lutte pour les droits indigènes à l’intérieur et à l’extérieur de la politique brésilienne, sa participation auprès de Álvaro Tukano, Marcos Terena et Raoni Metuktire dans la constituante de 1998 a initié une nouvelle phase de visibilité aux peuples originaires du Brésil, en garantissant et légitimant le droit à la démarcation de leurs terres, un virage récent dans l’histoire du pays et qui souffre actuellement de beaucoup d’harcèlements et de tentatives de sabotage par le gouvernement actuel.
Les épisodes partagés dans l’interview sont tellement nombreux que pour réaliser cette introduction sans intégrer le contenu des prochaines pages, car il est clair qu’il vaut mieux entendre les mots d’Ailton qui sont bien meilleurs, j’ai eu besoin d’enlever mes chaussures afin de toucher la terre ferme et de pouvoir écrire quelque chose qui a du sens sans être dans la redondance ou la répétition des nombreux textes qui le présente déjà brillamment. Les pieds sur le plancher de l’appartement, je sens la chaleur du bois ; ancien arbre venant d’un territoire lointain ; qui à ce moment vibrent seulement avec l’intense mouvement matinal de la boulangerie du rez-de-chaussée de l’immeuble ; en dessous de celle-là des mètres de ciment de la fondation du bâtiment, et seulement après tant de matériel et d’histoires superposés, je suppose qu’on arrivera enfin à la terre. C’est des perceptions qui peuvent paraître banales, mais à chaque fois que je suis hypnotisée par le discours d’Ailton, je me prends à réfléchir et à scruter chaque centimètre qui m’entoure. Au contraire de ce qui peut paraître, je ressors de ces profonds voyages en tentant de sentir le territoire avec la profondeur interprétative de Krenak.
La déconnection n’est pas mythologique ou particulière comme cela peut paraître au premier abord avec les textes du professeur et écrivain Krenak ; elle est matérielle, palpable comme la distance entre nos corps et la terre, proportionnée par le centimètre et les kilomètres occultés de l’histoire du processus de fabrication du propre parquet de l’appartement. C’est des distances quotidiennes de notre monde urbain, de production et d’intenses processus de déconnection et d’omission d’histoires. La connexion visible et invisible entre le territoire et ses habitants traverse des concepts importants pour capter la perception d’Ailton sur le monde et le citoyen, et aussi sur le sens « d’être à la campagne ». Des perceptions distantes de la réalité des villes, mais qui peuvent, de la meme manière, résonner à sa manière avec spontanéité et vigueur dans celle des périphéries urbaines et ses puissances.
La puissance est une clé centrale entre les deux personnalités qui dialoguent : Jailson Sousa Silva et Ailton Krenak, l’intervieweur et l’interviewé. Ce n’est pas par hasard que la puissance réverbère dans cette interview en divers points, non seulement dans les concepts élaborés par Ailton, mais elle l’est intégralement dans sa personnalité et l’intérêt multiple de l’interlocuteur pour le passé et le présent des peuples indigènes du Brésil, ce qui emmène cette interview vers des lieu inconnus de réflexion aussi bien pour Krenak et Jailson, que par conséquence, pour le lecteur lui-même.
La lecture de cette interview est large et profonde et c’est pour cela qu’elle a été divisée en deux partie. La première à un ton plus historique, et présente les bloques thématiques suivants : les Trajectoires, la Théologie de la Libération, la Dictature Militaire et l’ « Émancipation ».
La seconde partie de l’interview, ne se dissocie pas du monde contemporain. Elle aborde dans ses bloques thématiques : Le Temps du Mythe, l’Éducation, la Reforestation, la Jeunesse Indigène et la Démocratie et la Mondialisation.
Il nous est pratiquement impossible de dispenser quelque ligne du contexte politique que nous vivons, c’est fondamental, comme un traitement homéopathique, exercer l’écoute et l’approche des peuples originaires pas seulement par la récupération d’une mémoire mais par une cure progressive à partir des ces voix fortes qui résonnent et qui reprennent l’histoire de la terre muette au travers nos racines.
Julia Sá Earp
ailton krenak
la puissance du sujet collectif
partie I
trajectoires
Jailson de Souza e Silva: Les biographies sont des références de parcours construits dans nos vies personnelles et socialement. On peut commencer comme ça ? Mets-toi à l’aise.
Ailton Krenak: Je pense que les biographies ont le pouvoir d’évoquer les parcours de notre formation et de notre vie, de notre expérience engagée, aussi bien dans le contexte local, quand on vit dans une petite communauté, ou quand on arrive à dépasser les limites de cette communauté, où nous nous sentons protégés par la mémoire et l’histoire, que chacun d’entre nous peut expérimenter. Dépasser ces limites de la communauté c’est une rare expérience que certaines personnes réalisent consciemment, de manière active. La majorité d’entre nous, arrachés à cette ambiance confortable, de la vie familiale, de la convivialité dans le cas d’une communauté indigène, ou l’une de ces communautés autonomes qui vivent à la périphérie du social, cette ambiance où la vie prospère malgré les arrangements politiques et en général. C’est comme si on vivait dans l’isolement du monde planifié, où il y a beaucoup d’inventions.
Ce sont des inventions que l’histoire sociale ne retient pas. Je pense que pendant longtemps ces vies ont été des expériences invisibles, de gens merveilleux qui ont réussi à élever leurs enfants, à créer une communauté, à protéger un territoire, à créer un sentiment de territorialité dans lequel ce complexe d’échanges, de familles, de camaraderie se passent et les enfants grandissent dans ce milieu avec une puissance, une capacité, une liberté si merveilleuse. Ce monde finit par se construire comme une biosphère ; lieu où ces vies arrivent à une centaine d’années, ou même plus, se sont des sages, des personnes ayant des trajectoires riches, mais qui ne se connectent pas aux réalités complexes du monde global, ce que nous comprendrons plus tard. Dans mon cas, on a été arrachés (ou expulsés) à notre territoire trop tôt, parce que nous vivions dans un contexte de communautés qui était déjà perçu comme intégré ou disparu, des communautés indigènes. Comme si c’était le reste des indiens qui avait survécu à la colonisation du fleuve Rio Doce, mais qui avait encore des modèles d’organisation qui impliquaient l’accès commun aux choses. Avoir l’accès commun à l’eau, au fleuve, à l’endroit où on pouvait aller chercher de la nourriture, à l’accès à la sociabilité qui concernait la vie de beaucoup de personnes. Ces collectifs, c’est ce qu’on appelle communauté. Je pense que lorsqu’ils appellent ces collectifs, communautés, ils les vident un peu de la puissance qu’ils ont et on crée une situation idéalisée de communauté – ils n’arrivent pas à problématiser la vie de ces personnes.
Tirer une biographie d’un environnement comme ça c’est une manière d’éclairer tout ce milieu et de donner un sens à la vie de tout le monde ; nos grand-parents, nos oncles, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis d’enfance. C’est un vaisseau. C’est une constellation d’êtres qui sont en train de voyager et transiter autour du monde, mais pas autour de celui de l’économie et des marchandises, mais dans le monde des vies mêmes, des êtres qui vivent et expérimentent la constante insécurité. C’est comme si ces mentalités, ces personnes avaient besoin d’un monde étendu pour pouvoir expérimenter leur puissance d’êtres créateurs. Des personnes qui ont grandi en entendant des histoires profondes qui racontaient les événements qui ne sont pas dans la littérature, dans les narratives officielles, et qui traversent le plan de la réalité en direction du plan mythique des narratives et contes. C’est aussi un endroit d’expression orale, où le savoir, la connaissance, son véhicule est la transmission de personne à personne. C’est le plus âgé qui raconte une histoire, ou le plus jeune qui a eu une expérience qu’il peut partager avec le collectif dont il fait partie et s’intègre au sens de la vie de chaque sujet, en enrichissant l’expérience de vie de chaque sujet et aussi en créant un sujet collectif .
"C’est le plus âgé qui raconte une histoire, ou le plus jeune qui a eu une expérience qu’il peut partager avec le collectif dont il fait partie et s’intègre au sens de la vie de chaque sujet, en enrichissant l’expérience de vie de chaque sujet et aussi en créant un sujet collectif ."
Cette perception du sujet collectif survient très tôt chez nous. Je devais avoir environ 17 ans quand moi, mes parents, mes frères, un oncle et quelques cousins plus jeunes :on s’est tous entassé dans une caravane pour quitter notre lieu d’origine, à la recherche d’une autre piste d’atterrissage, un autre lieu pour continuer à vivre. Et on ne se posait pas trop de question sur comment aller être cet autre endroit, c’était un endroit qui pourrait reproduire l’expérience collective, du continuer à vivre ensemble.
On partait du Rio Doce pour le monde. Imaginons qu’il y avait une destination qui était le Parana. Ce groupe qui déjà était parti du Rio Doce dans la seconde moitié des années 60, en 1966, 1967, avait expérimenté la dissolution des collectifs que l’on vivait à travers la violence qui arrivait là-bas avec l’occupation de ces territoires, avec la dispute des terres, des conflits fondateurs aigus et une négation permanente de notre droit d’être et d’avoir une expérience de vie collective. Nos voisins avaient des terres, et même ceux qui ont pris la terre des indiens avaient des petites propriétés. C’était une famille, des personnes, des individus qui étaient propriétaires de ces terrains. La manière d’exister collectivement ne marchait plus à cet endroit, et c’est devenu invivable pour les gens de vivre collectivement à cet endroit. Ceux qui résistaient, c’était au coup de leur propre vie, il y avait des gens qui se faisaient assassinés parce qu’ils ne correspondaient plus à l’endroit. On a dû chercher un autre endroit.
Je fais partie de la génération de l’exil de notre peuple, de quand beaucoup de gens sont partis et sont allés à Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso. C’est comme si c’était une fuite presque sans destin, pour un exil dont on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais je pense qu’en fait, tout le monde avait l’espoir de pouvoir revenir – un peu comme les gens du Nord-Est qui viennent à Rio et São Paulo, mais comme si c’était un : « je sors, mais j’arrive tout de suite ». Parfois ce « j’arrive tout de suite » n’arrive pas et on tombe dans le grand océan des événements de la vie. Quand j’ai vu à la sortie de São Paulo, où on s’est installé, pour essayer de survivre, sans aucune référence au milieu des « paulistas » (habitants de la ville de Sao Paulo) et des autres migrants qu’étaient déjà là, on a commencé à sentir un malaise en s’installant comme sujet dans ce contexte.
Je regardais autour de moi, ça collait un peu au temps de la dictature militaire, et les gens ne savaient et ne comprenaient pas toujours ce qu’on vivait. C’est à cet âge que j’ai commencé à regarder autour de moi et à comprendre qu’il avait un activisme d’ouvriers, de gens simples et très pauvres, se balançant d’un côté à l’autre en essayant de se faire entendre, d’être respectés et vus. On n’avait pas encore d’idée très claire de ce qu’était cette chose, ces droits qui étaient lointains, les célèbres droits de l’Homme, mais il y avait cette gêne : celle de l’invisibilité. Si on vit une expérience de communauté, l’idée d’individu est rigoureusement constituée comme personnalité propre, avec des perspectives propres, en interaction avec ses semblables. Ce sentiment d’interagir avec ses semblables est fondamental pour qu’on puisse être une personne équilibrée. On ne passe pas tout notre temps à faire des efforts pour créer des relations, on est à l’aise dans la communauté. Chacun est comme il est, il n’a pas une norme – personne ne s’étonne si on prend une décision ou une autre.
"Si on vit une expérience de communauté, l’idée d’individu est rigoureusement constituée comme personnalité propre, avec des perspectives propres, en interaction avec ses semblables. Ce sentiment d’interagir avec ses semblables est fondamental pour qu’on puisse être une personne équilibrée."
Mais quand on tombe sur le champ miné de l’exil, on doit mettre à jour notre mémoire tous les jours ; ce qu’on fait là-bas et ce qu’on veut.
C’était quand j’ai commencé à comprendre qu’il avait les Guaranis (peuple indigènes) là-bas, à São Paulo, sur le plateau, il y en avait quelques-uns du littoral que je ne connaissais pas et que j’ai connu quelques années plus tard. Mais, environ à partir de 1975 , je voyais déjà le mouvement des Guaranis, essayant de survivre autour de São Paulo, en étant expulsés .
Jailson de Souza e Silva: En étant expulsés du barrage, c’est ça ?
Ailton Krenak: Oui, du barrage Billings. Ces gens, qui sont à Parelheiros, à Jaraguá, souffrent de tout… La même expulsion dont nous avons souffert à Rio Doce, ils souffraient là-bas aussi. J’ai commencé à fréquenter et à rendre visite aux membres de la famille, à comprendre le mouvement qu’ils mettaient en place et j’ai commencé être présent dans certaine de ces situations, mais je me sentais encore exilé. Je sentais toujours que je n’étais pas chez moi.
J’ai compris que je pouvais avoir un poids plus important dans ce mouvement qu’ils préparaient, comme en virant quelqu’un qui exploitait le palmier dans la région où l’on chassait et où l’on récoltait, mais à partir de ce moment là, un particulier s’en occupait, et c’est comme ça qu’a commencé la dispute de la terre. On s’est rendu compte qu’il avait une voie de revendication concernant le sujet, avec l’État, avec la municipalité. Nous avons commencé à inventorier et bientôt nous frappions à la porte de Funai, à Brasília. On frappait à la porte et on revendiquait ce qui se sont révélés être pour nous, des droits.
C’est intéressant cette chose, l’idée d’un droit, la perception qu’il existe un droit et que l’on peut constituer ce droit, on n’a pas besoin d’attendre qu’il se présente à nous, mais on part à sa recherche – ça m’animait déjà très tôt.
Avec peu d’outils pour interagir et intervenir, mais avec beaucoup d’angoisse et avec l’espoir d’ouvrir de nouveaux chemins, j’ai commencé à participer à des initiatives qui réaménageaient ces collectifs, quand tu commences à agir dans une communauté ou une autre, que ce soit même dans une communauté mise à l’écart dans ces quartier pauvres, qui luttent là-bas pour avoir un pinguela (pont de liane) sur le ruisseau, parce que quand il pleut, ça inonde tout. Alors, qu’est-ce que tu as à revendiquer ?
"une minute, c’est quoi cette terre, c’est quoi cet endroit, c’est quoi cette communauté que nous avons créé ici ?"
Un passage. A partir de ces petites questions, on commence à regarder autour de nous et dire: « une minute, c’est quoi cette terre, c’est quoi cet endroit, c’est quoi cette communauté que nous avons créé ici ? » Et ça suscite beaucoup d’inquiétudes, ça éveille la puissance de sujet qui jusqu’à présent ne fait pas attention à cette idée de citoyen, parce que cette idée est très sophistiquée. La plupart des gens qui migrent dans leurs vies pour quitter l’espace de vie ne se réveillent pas parce qu’ils ont déjà une idée de ce que c’est être un citoyen, c’est un sentiment naturel de chercher l’air pour respirer, vivre ensemble, pourvoir faire la fête, partager la nourriture et les choses.
Ma formation coïncidait beaucoup avec cette chose de la culture brésilienne, quand nous tous étions en pleine intégration dans ce truc du marché. Les familles qui vivaient à la campagne devaient tout à coup apprendre à compter l’argent, à rentrer dans un magasin et acheter, à faire les comptes et payer ensuite, à mesurer la taille des choses. A travers l’imaginaire, c’est projeter une cartographie des mondes, des endroits où l’on circulait. C’est par un océan comme celui-là que s’est éclairé mon chemin comme militant. J’ai regardé tout ça et j’ai pensé, oh Mon Dieu, je suis fait comme un rat, je peux aller chercher un emploi dans une usine et disparaître dans l’un de ces trous (à rat). Aller au SENAI, devenir un opérateur des machines industrielles, un fabricant d’outils ou passer toute sa vie comme assistant d’usine, parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont vécu comme ça, qui sont nés à la campagne et après se sont modernisés, sont devenus des ouvriers, des travailleurs.
C’est intéressant comme quelque chose en moi me disait que je n’étais pas un gars du monde du travail, du monde de l’engagement, de cette chose de vendre mon travail en échange de quelque chose dont j’avais besoin – une école, une maison, une voiture, un bien.
C’est ça qui rythme la vie des gens exilés de leurs lieux d’origine. Chacun dans son lieu d’origine est totalement intégré s’il vit 60 ou 80 ans dans une usine de farine où il moud pour faire de la « rapadura » (farine de magnioc), il est satisfait. Sa création, son univers d’invention et de création est comblé. Mais quand il est arraché de ce lieu et jeté ailleurs, il faut se réorganiser. Le déraciné s’en va alors se réinventer lui-même ainsi que son monde. Je pense que j’avais une soif, une envie que cette réorganisation ne soit pas seulement celle de l’individu, de ma personne, mais qu’elle entraîne avec moi, ma famille, les personnes qui avaient un poids et du sens dans ma mémoire affective, dans mes relations familiales et tout. Je ne voulais pas tenter ma chance tout seul. Je pense que c’est à partir de là que j’ai compris qu’on devait mener une lutte plus ouverte, et puis j’ai commencé à remarquer qu’il y avait les Xavantes, les Guaranis, les Caingangues, qu’il y avait d’autres familles expulsées de leur terre. […] Et que notre place n’était pas dans ce nouvel endroit.
Là-bas, tout le monde avait sa place, et puis on a commencé à se demander où était notre place . Son embryon qui est devenu le mouvement des indigènes, que j’ai aidé à penser, on peut même dire, à concevoir. Il est né de gens qui avaient à peu près mon âge, ça partait du plus âgé, Mário Juruna, Álvaro Tucano, Marcos Tereno et un collectif d’autres jeunes indigènes qui étudiaient à Brasília. Eux aussi ont esquissé l’idée d’une association d’étudiants, l’UNINDE – Union des Jeunes Etudiants Indigènes. Leur esquisse, c’était ce truc des étudiants.
Jailson : Le nom était « étudiant » et l’adjectif était « indigène »?
Ailton Krenak : C’est ça. Mais quand moi et Álvaro Tucano, qui avait été expulsé de Alto Rio Negro par les Salésiens, par l’ordre religieux qui était là-bas et l’a excommunié, l’a mis dehors, parce qu’il est allé avec Mário Juruna au Tribunal Bertrand Russel, dénoncer la dictature, le génocide indigène, quand il est rentré au Brésil, les prêtres ne l’ont pas laissé rentrer à Rio Negro. Il a fait sa formation avec moi et d’autres membres de la famille, comme avec Ângelo Kretan, Nelson Xangrê et quelques autres parents guaranis qui sont venus du « planalto paulista », dans la banlieue de São Paulo, où il y a des réserves indigènes, et on a commencé à observer et être observés par les mouvements des Pastorais da Terra (organisme lié à l’Église Catholique durant la dictature militaire), qui sont devenus le CIMI – Conseil Indigène Missionnaire. C’est dans ces communautés de base, dans ce milieu là, qu’on a cultivé nos alliances.
théologie de la libération
Jaílson : La théologie de la libération a été un espace de dialogue pour vous ?
Ailton Krenak : Bien sûr que oui, parce qu’ils créaient un flux, ils nous donnaient la possibilité de se déplacer et aller aux rencontres des communautés. Je me rappelle que l’une des premières fois où j’ai eu un véhicule pour faire entendre ma voix, ça a été dans l’une de ces campagnes de fraternité, quand on était encore dans celle-ci…
Jaílson : Ça s’est passé à la fin des années 1970 ?
Ailton Krenak : Fin des années 70, début 80, j’étais déjà impliqué dans ces débats. Il a eu une campagne de la fraternité avec comme thème : « du pain pour le monde » je crois, ou « le pain c’est la vie », qui traitait de la question de la faim. On vivait dans des communautés de la faim. Aujourd’hui, si on dit qu’il y avait des communautés qui mouraient de faim, où le peuple mourait de faim, on peut encore entendre : « non, mais ça était au début du XXeme siècle ». Non, ça s’est passé à la fin du XXeme siècle. C’est pour ça qu’il y a le Betinho1Hebert José de Sousa, sociologue et militante pionnier des droits humaines au Brésil. . Je ne le connaissais pas encore, ses campagnes non plus. C’est plus tard que les campagnes du Betinho se sont établies. Mais le diagnostic de la faim barbare, qui tuait des milliers de personnes, avait déjà été fait bien avant. Donc, je pense que c’était dans l’une de ces campagnes « du pain pour la vie », ou « le pain c’est la vie », « de partage du pain », qu’ils se sont servis de mon discours et ont transmis mon image, et c’est devenu viral. Jusqu’au Nord-Est, l’Amazonie, partout où une brochure arrivait de la Prelazia, ou une image à la TV, ce petit gamin faisait son apparition en disant quelque chose.
Et ça a élargi ma perspective à propos d’avec qui je pouvais parler, et j’ai commencé à me rendre compte que je pouvais parler avec d’autres plages et d’autres personnes, que je pouvais parler à d’autres personnes que les sans-abris des périphéries des grandes villes, comme São Paulo, ou Rio de Janeiro, Curitiba. Moi aussi je pouvais parler avec les gens qui étaient dans la forêt, avec mes parents imaginaires quelque part dans la forêt. Et on a commencé à envoyer un message, comme si on l’envoyait à une autre planète. Envoyer un message aux parents qui vivaient dans la forêt. On allait à la rencontre, en faisant cette communication à distance, on enregistrait des messages sur cassettes pour envoyer aux villages, on croyait qu’il avait quelqu’un de l’autre côté qui pouvait comprendre ce qu’on disait.
Je pense que c’était le premier environnement de sustentation d’une idée de mouvement social élargi, où le peuple indigène était le protagoniste. Où on n’était pas non plus ceux qui attendent le plat de secours, ou le manteau, l’aide. C’était quelqu’un qui assumait l’initiative de commencer à discuter de la réalité qu’on vivait.
Ailton Krenak : C’était très curieux, parce que c’était à cette époque que l’État a décidé d’émanciper les indigènes. C’était à la fin des années 70, pendant le gouvernement de Geisel. Ils ont décidé qu’ils allaient faire une campagne d’émancipation en [19]76. Ils ont mis en place la devise de l’émancipation, une réforme de l’État, avec la question de la terre, des droits civils même. On peut dire que c’était la plus grande période d’usure de ces relations, quand l’État a décidé de dire que tous ces gens-là qui pensaient être indigènes, ne l’étaient plus. Cette violence de l’État destructeur frappait les Ianomâmis, les Xavantes, les Ticunas, les Guaranis, jusqu’à tous les indigènes urbains et périphériques, c’était la première opportunité qu’on a eu de constituer une coalition d’indigènes.L’État a attaqué, et la coalition est arrivée.
"Cette violence de l’État destructeur frappait les Ianomâmis, les Xavantes, les Ticunas, les Guaranis, jusqu’à tous les indigènes urbains et périphériques, c’était la première opportunité qu’on a eu de constituer une coalition d’indigènes."
Soudain on avait à la même manifestation de gens comme le Daniel Cabixi, qui venait du Mato Grosso, Aniceto Celestion, qui étaient les leaders des Xavantes et qui ne maîtrisaient même pas le portugais, malgré le fait qu’ils avaient un discours bien marqué parce qu’ils étaient des étudiants des Salésiens, ils étaient des catéchistes des Salésiens et parlaient le portugais presque comme les prêtres. Mais ils ont compris quelle était la puissance et la capacité d’animer le débat à propos des droits des indigènes, et on a ouvert les yeux. C’est quand Marçal de Souza a dit : « le Brésil n’a pas été découvert, il a été envahi ». L’indigène kaiowá guarani du Mato Grosso du Sud, au fond d’une ferme de l’impénétrable latifundium, a crié et s’est débattu: « le Brésil n’a pas été découvert, il a été envahi ». Il l’a dit en 76. Et, c’est à ce moment là que tout s’est enflammé, la répression a débuté dans les villages d’une façon assez violente. À cette époque là les directeurs de la Fondation Nationale des Indigènes étaient des généraux, des colonels, qui d’ailleurs, est la tendance de nos jours. On avait un général en pyjama à la tête de la FUNAI, par contre, à cette époque ils étaient en uniforme et armés. Et ils réprimaient vraiment, les commandes militaires n’étaient indulgentes dans aucune région du pays.
Il y avait des jeunes indigènes parmi nous qui étudiaient aux écoles des Salésiens, qui étaient mis de côté des missions religieuses dispersées dans les états de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre et Alto Rio Negro. Ces jeunes lisaient, écrivaient et commençaient à accorder de l’importance aux messages que les anciens et les plus âgés faisaient passer, à la suite des paroles comme celles de Marçal de Souza, qui a dit que le Brésil n’a pas été découvert, mais qu’il a été envahi. Regarde quelle annonce, regarde quelle chose merveilleuse pour poser les fondations à ce qui est en train de naître. Il ne rampait pas, quand il est né, il était déjà debout en disant « le Brésil a été envahi ». Donc s’il a été envahi, notre devoir était de le reprendre. C’est là qu’on a commencé la lutte pour la délimitation des terres indigènes. C’était une campagne pour la délimitation des terres, et une campagne pour les droits des indigènes.
La première rencontre qu’on a fait s’appelait « Indigènes, les droits historiques », regarde ça. Les droits étaient historiques, ils ne sont pas à venir (ils le sont déjà).
On demandait ce qu’on nous avait enlevé. À cette première rencontre il y avait des gens de 68 éthnies, à un moment où les documents officiels signalaient 120 peuples au Brésil. On en a rassemblé 68. Plus tard ils ont dit qu’il y en avait 180. Il y en a encore aujourd’hui qui répètent qu’il y a en 180, beaucoup de documents officiels signalaient qu’il y avait 180 éthnies ou peuples, toutefois ils oublient que nous sommes plus de 300, peut-être beaucoup plus que ça. Les chiffres de l’époque signalaient d’ailleurs qu’au Brésil il y avait environ 120, 150 mille indigènes, parce qu’ils comptaient à partir des villages. Quand on parle de villages, on parle de différentes situations réelles, dans lesquelles ces parents ont été piégés et ségrégués sur quelques-uns des territoires, et ils n’avaient aucune chance de survivre. Avec une administration fédérale sur leur dos, contrôlant même la vie, au point que quelques-uns ne peuvent pas partir de leur village pour une autre région sans avoir un laissez-passer que le chef du poste de sécurité devait approuver.
Jaílson : Camp de concentration ?
Ailton Krenak : Oui, et sans le laissez-passer on ne circulait pas. Et ceux qui n’avaient pas de laissez-passer n’étaient pas perçus comme indigènes. Si tu circulais par-là et qu’un chef du poste de sécurité ne te contrôlait pas, tu n’étais plus un indigène. Au delà de ce jugement, de dire que ceux qui portent des pantalons en jeans, une montre et des lunettes ne sont plus indigènes, ils pensaient aussi que ceux qui circulaient sans la carte et sans l’abonnement de transport de la FUNAI et du chef du poste de sécurité, ils n’étaient plus indigènes. « Ils sont déjà émancipés ». Donc, l’émancipation était imposée. Au lieu d’avancer l’exercice de la citoyenneté, plutôt qu’avoir une perception que c’était une avancée en vue de la conquête des nouveaux espaces pour exprimer la citoyenneté, c’était compris comme une main tendue à l’émancipation. Je me rappelle qu’il y avait une énorme queue à l’INPS2 Institut National de Prévoyance Sociale qui tournait à un coin de rue et à un autre et qui disparaissait dans d’autres rues. Au bout de cette queue il y avait quelques copains tous beaux, ils ressemblaient aux lutteurs de Huka-huka (lutte traditionnelle) de Xingu. C’était la fin de la queue de l’INPS, la fin de la queue des pauvres. C’était là où ils mettaient les « émancipés ». Donc, l’émancipation des indigènes, c’était de les mettre à la fin de la queue de la pauvreté.
On devait lutter contre la stigmatisation qui était inscrite dans notre destin commun, celui de mettre tous les indigènes à la fin de la queue des dépossédés de tous.
Je pense que le mouvement a été une réaction face à la négation de notre existence, contre la négation de nos droits historiques et notre opportunité d’inventer d’autres formes d’être, quelles qu’elles soient, mais qui impliquait surtout le respect des territoires où notre peuple pouvait encore résister, rester en vie. Cette chose qui articulait l’idée de droits humains avec le territoire était presque unanime auprès de la majorité de ces camarades de mon âge. Et pour les plus vieux, ça a été une révélation. Si pour les plus vieux l’idée de territoire était magique, une idée née d’un mythe, il y avait désormais leurs fils et petit-fils qui disaient que malgré le fait que cette chose viennent des récits ancestraux, elle avait aussi un équivalent ici-bas, à l’extérieur du monde : le droit était à nous.
C’est la découverte d’un monde extérieur, où il y avait un corps de représentation de cette société, qui au-delà d’être destructrice, il y avait au sein de celle-ci des institutions qu’on devait connaître et à l’intérieur on pouvait secouer le cocotier pour faire tomber les fondements de ce qu’on considérait nos droits.
Le document le plus percutant que l’État avait en sa possession pour répondre à notre demande était le Statut de l’Indigène, loi 6.001. Une loi qui a été faite sous la dictature, qu’il considérait comme une pièce fondamentale pour que l’État n’écrase pas le reste des indigènes, donc il disait : « Du calme, si vous rompez le lien avec l’État, faites attention, parce que si vous mettez fin à cette loi 6.001 vous allez mettre fin à la dernière barrière, bien qu’elle délimite encore un endroit obscure, mais où vous êtes encore reconnus. En dehors de cette limite, vous faites partie de la masse générale des dépossédés et des déracinés». Cette catégorie et ce secteur n’étaient même pas identifiés. Ça veut dire que même pour atteindre ce statut, le pauvre doit se mettre au travail, il faut travailler dur, dans la condition citoyenne la plus désolée, pour devenir un sans-terre.
"On devait lutter contre la stigmatisation qui était inscrite dans notre destin commun, celui de mettre tous les indigènes à la fin de la queue des dépossédés de tous."
Dans le cas des peuples indigènes, je pense qu’on a été à la limite de la disparition. Au moment où on a mis en place l’alerte « en voie de disparition », on a abouti à un mouvement social inventif, bien que très affaibli à cause du contexte historique de l ‘époque, mais qui était déjà inscrit dans l’histoire.
Voilà pourquoi c’est possible de le désigner comme un contexte historique. L’État nous a attrapés la jambe et nous sommes sortis la tête haute, on a sauté de joie et on a crié. Je pense que la première reconnaissance de l’émergence des droits est venue des intellectuels, de l’université, comme celui que j’ai déjà mentionné plus tôt, Darcy, mais il y en a eu d’autres, des gens aussi importants que lui, qui ont poussé les indigènes au débat partout dans le pays, ils les ont menés à la scène et à la parole publique.
les frères villas-bôas
Jailson: Comment les frères Villas-Bôas ont pris part au combat ?
Ailton Krenak : Les frères Villas-Bôas étaient les « capitães do mato » de l’état, ils ne voulaient pas que les indigènes redeviennent indigènes. Les Villas-Bôas pensaient que les indigènes de Xingu étaient déjà de trop ; les 17 ethnies qu’ils ont mis sur l’arche de Noé devaient rester là-bas, pour les autres, le déluge devait les emporter. S’il ne les a pas entraînés, c’est parce qu’ils ont pris leur temps. D’une certaine façon, ils pensaient que c’était un retard pour la modernisation de l’État brésilien, d’avoir laissé que tant de frontières et de périphéries se soient laissés occuper par les «beiras de rios», «igarapés», «pés de serra» et continuent à résister. C’était inimaginable pour les frères Villas-Bôas que les Xacriabá puissent, à la fin du XXeme siècle, renaître comme un peuple fort et capable de revendiquer leurs droits dans le domaine politique et social de sa région, et consolider une présence comme celle que les Xacriabá ont mis en place au nord de Minas Gerais. Ou comme les Maxacali font, ou les Krenak aux bords de ce fleuve dans le coma, le Rio Doce, où les compagnies minières s’engagent solidairement à détruire les montagnes.
"Chaque « igarapé » a son nom, et son nom est une invocation à d’autres êtres, des liens de parenté, des contes les plus anciens qui arrivent à notre mémoire. Ça donne un sens pour nommer la terre : mère, parce qu’elle n’est pas une chose ; elle n’est pas une parcelle de terre, un lot, un terrain, une ferme."
Comme disait Carlos Drummond de Andrade, ils suivent très vite, avec la détermination d’emballer ces montagnes, de les mettre dans un navire et les envoyer à n’importe quel putain coin du monde. Cette détermination de dévaster le paysage et de détruire ceux qui voient le paysage comme son reflet, qui chantent pour la montagne et le fleuve, qui dansent pour la montagne, qui nomment les fleuves.
Chaque « igarapé » a son nom, et son nom est une invocation à d’autres êtres, des liens de parenté, des contes les plus anciens qui arrivent à notre mémoire. Ça donne un sens pour nommer la terre : mère, parce qu’elle n’est pas une chose ; elle n’est pas une parcelle de terre, un lot, un terrain, une ferme.
Malgré ses efforts pour la mettre sur le marché foncier et enlever la raison de vivre que la terre a, ces gens qui sont nés sur la terre et qui ont la mémoire de la terre n’acceptent pas ça. Ils se battent, meurent et réapparaissent encore d’une autre manière, et continuent à lutter et à crier en disant que c’est la terre mère.
Le mouvement indigène est né avec la conscience de fils de la terre mère et avec la capacité active de la critique politique, comme celle de Marçal, de dire que le Brésil n’est pas été découvert, mais en fait, envahi. Donc, ces bases conceptuelles qui ont soutenu la pensée de ma génération pour penser au mouvement indigène sont vivement formées par notre héritage culturel ; elles ne sont pas un conseil venu d’ailleurs, elles sont venues d’une profonde implication de ces individus avec leurs collectifs. C’est peut-être pour ça que ce mouvement, bien qu’il soit toujours engagé dans tous les débats à n’importe quelle époque, que ce soit sur la crise politique ou quand le Brésil est à un moment d’abondance, il apparaît pour affronter Belo Monte, il dit non aux barrages et aux centrales hydrauliques, aux ports, à cette infrastructure de l’État, parce que l’État est l’envahisseur continu du processus que Marçal de Souza a dénoncé dans les années 1970.
Ça veut dire qu’il n’a pas de découverte, c’est une invasion continue, et l’État est l’acteur principal de cette invasion – tout l’appareil de l’État avec ses institutions. Les frères Villas-Bôas, dont tu te rappèles, représentent, du point de vue de l’histoire de cette vague croissante qui a donné au mouvement indigène, le conservatisme indigène, qui pensait qu’on devait avoir, comme il y a des réserves biologiques, une pour garder ces héritages culturels, qui a donné cette origine sociale importante d’indigènes, noirs et blancs comme base de la formation de la civilisation tropicale brésilienne.