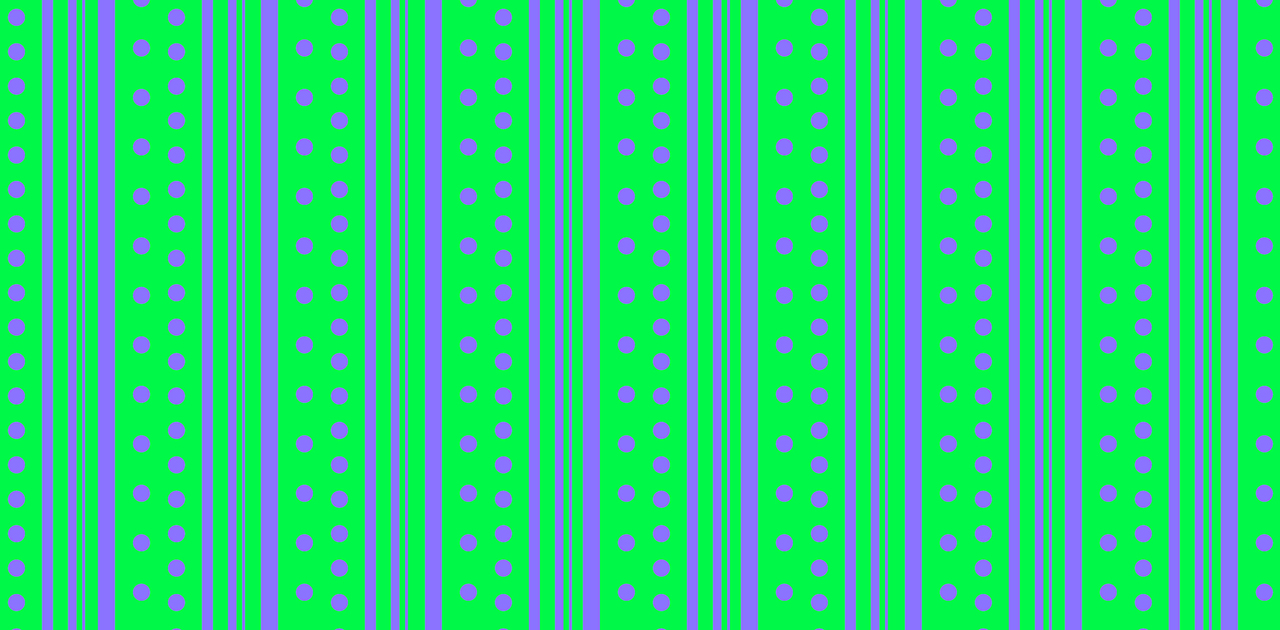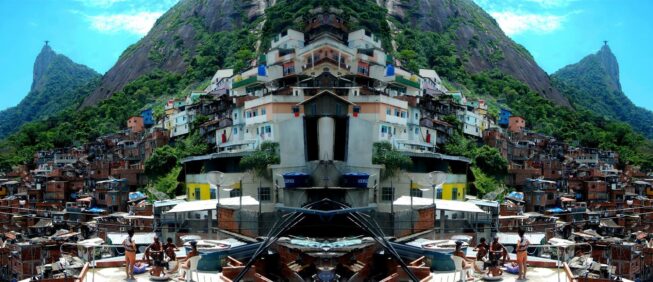Cette dame frappe bué
Yara Nakahanda Monteiro
| Angola |
15 de juin de 2023
traduit par Renee Edwige Dro
extrait traduit de Essa dama bate bué!,
(Guerra e Paz Editores, 2018)
*
Le gardien se réveille en sursaut à cause de la lumière de la torche. Il se lève. Il lui faut un moment pour se stabiliser. Il y parvient. Essayant de comprendre ce qui se passe, il court vers la rue.
— Tinoni, on te paye pour dormir ? — demande Katila qui connaît la réponse.
— Je suis désolé.
— Si je reviens et je te vois dormir, je le dirai, le menace-t-elle en fermant la fenêtre de la voiture.
Tinoni, pris de peur et humilié, baisse la tête.
On monte dans la jeep. Un rappeur avec une voix douce et une langue acérée joue à fond sur les haut-parleurs, Top dollar with the gold flea collar, Dippin' in my blue Impala...
On fait les présentations. Ricardo conduit et Edson est sur le siège passager avant. Ils se plaignent du retard, mais sans perdre leur sang-froid.
On entre dans le front de mer de Luanda. La débauche de lumières provenant de l'éclairage de la baie et des bâtiments gouvernementaux contraste avec l'obscurité des résidences. Les palmiers et l'eau empruntent l'aspect d'une ville sous les tropiques. Les routes et les trottoirs sont dégagés. Le chaos s'est retiré pour la nuit. Ce n'est pas sa scène.
Luanda est magnifique la nuit, je me dis. Je suis ravie de la regarder.
Le trajet est court. Ils garent la voiture dans une rue du centre-ville, près d'une petite église blanchie à la chaux et entourée d'un cadre jaune. Deux tours jumelles protègent l'entrée voûtée. C'est une église qui aurait pu être placée dans n'importe quel petit village portugais. Nádia et Katila prennent appui contre les garçons. Leurs talons ne sont pas faits pour les ruines du tortueux trottoir portugais. Pas loin derrière, je suis seule. Nadia m'appelle et me donne le bras.
Sur le chemin, des enfants nous courent après et me font peur à chaque fois. Katila rit.
— Où est mon gars Tonho ? — demande-elle au groupe d'enfants.
— Je vais aller le chercher, répond l'un d'eux avant de s'enfuir. Nous continuons à marcher pendant encore une centaine de mètres avant d’arriver au bar.
— Marraine, marraine. Je suis là.
— Ça va ? Donne-moi deux Malboro.
Tonho n'a même pas treize ans et pourtant il vend des cigarettes tard le soir.
C'est le décor d'un clip de musique hip-hop. La lumière est chaude et enveloppante. On fume à l'intérieur. Le bar est bondé, mais je me déplace facilement. Tous les hommes portent l’uniforme : la casquette de basket, le T-shirt, le jean baggy et des baskets Air Jordan. La hauteur des talons et les vêtements aguichants étouffent la concurrence féminine. Le groupe se disperse. Chacun à sa tribu.
Nádia, voyant que je me sens perdue, vient me chercher. Elle m'emmène avec elle au comptoir et salue le barman avec deux baisers sur la joue et un sur la bouche. C'est un grand métis aux traits androgynes. Il nous offre des shots de Gold Strike. On les boit à grandes gorgées.
— Qu’est-ce que tu veux boire ? — me demande-elle.
— Malibu cola.
Pendant que nous attendons nos boissons, des garçons et des filles viennent et saluent Nádia. Elle me présente et m'oublie rapidement. Ils partagent des accolades, s'embrassent et font des high five en l'air. J'ai l'impression que tout le monde se connaît dans ce bar.
La musique est forte. Les garçons secouent leurs épaules, lèvent les bras et tapent dans leurs mains. Parfois, ils ferment les yeux et proclament l'évangile du hip-hop. Ils ont les mains sur la taille. Les pieds légèrement écartés et les genoux pliés, ils font tourner leurs hanches vers l'avant, le côté, l'arrière, puis dans l'autre sens. Les mouvements suivent le rythme de la musique : Now give it to me. Gimme that funk, that sweet, that nasty, that gushi stuff...
La danse ne s'arrête que lorsque le DJ arrête de jouer. Je regarde ma montre, il est trois heures et demie du matin. Soudain, les lumières s'allument, aussi vives que les projecteurs d'un stade de football. Elles font mal aux yeux. On commence tous à fuir la lumière et à quitter le bar. Nous sommes les derniers à partir, faisant les mêmes 100 mètres pour retourner à la voiture. D'autres enfants arrivent. Ils nous suivent. Ils ne vendent pas de cigarettes. Avec leur main caressant leur ventre, ils demandent de l'argent. Personne ne les remarque. Nous montons dans la voiture. Les portières sont vite condamnées. On continue la ronde.
La route que nous empruntons est bondée de voitures. Soudain, la Mercedes ML noire du conducteur est encerclée. Sans peur, ils se jettent sur la voiture. Ricardo ne fait pas d'embardée. Je suppose qu'il pense que ce ne devrait pas être à la voiture d'esquiver les gens. Il est sûr de sa conduite et continue.
Nous marquons un arrêt et descendons de la voiture.
Edson crie sur un petit garçon émacié :
— Dégage de là.
J'ai peur. Le gamin ne s’enfuit pas et continue de nous suivre. De la poche de son pantalon, Ricardo sort un billet de banque et le lui tend en ordonnant :
— Maintenant, fous le camp.
— Ne lui fais pas confiance. À la première occasion, tu perdras ton portefeuille et ton portable, prévient Katila, irritée.
— Des drogués ! Ils devraient être à l'école, dit Edson, sans savoir s'il critique les enfants, la guerre ou le gouvernement, ou les trois à la fois.
Je ne vois pas de petites filles. Je ne vois pas de filles. Je ne vois pas de femmes. Je ne vois pas les autres coins où elles pourraient se trouver. Je vois la police. Ils surveillent la boîte de nuit.
Il y a une énorme file d'hommes qui attendent de l'autre côté de la corde, qui n'est ouverte qu'à la discrétion du videur. La corde est la frontière entre ceux qui sont les bienvenus et les indésirables.
Les Blancs entrent directement. Les métis sont triés et les noirs doivent attendre. Peut-être que la discrétion du videur est basée sur le capitalisme. Pour le videur, un Blanc à Luanda est susceptible d'avoir plus de dollars à dépenser que les autres.
Nous nous dirigeons vers la porte latérale. Il n'y a pas de queue. Nous sommes des VIP. On est sur le point d'entrer quand un noir, presque un nain, apparaît. Il porte un trilby d'un blanc impeccable. Ses muscles collent à sa chemise. Où qu'il aille, tout le monde le salue
Nous décidons de ne pas entrer.
— Grand Poète Petit Betinho, ça va ? — lui demande Nádia.
— Ça va.
— Déclame quelques vers pour secouer les gens —lui demande Edson. Betinho passe sa main sur la couronne de son chapeau et, dans un mouvement circulaire, lisse ses doigts le long du bord feutré. Doucement, il tire les plis de son pantalon jusqu'aux genoux et le secoue. Il ouvre les bras et, comme pour annoncer le début d'un spectacle, chante :
— Frères et sœurs, bonsoir à vous!
Le public approche.
Betinho humecte ses lèvres, se racle la gorge et déclame :
C’est bien
Bae vit dans la foi
Nous aime tous
Elle déchire
Le jour vient
C’est un problème
La joie est partie
La vie est un dilemme
Luanda ma kamba
Uau é!
Luanda mon bébé
Tu déchires!
Frères et soeurs
C’est un sentiment
De rythmes fous
En ce moment !
Cette fille déchire !
Luanda ma kamba
Uau é!
Le public, submergé par l'émotion de Betinho, applaudit à rompre et s’écrit « Olaré ! ».
Des voix derrière demandent à tout le monde de se taire.
— Arrête avec ces illusions, se moque Katila, la main sur la taille.
— Betinho est dans la place. La famille est compliquée, mais c'est la nôtre, plaisante-il en faisant circuler son chapeau et en demandant des contributions.
Un blanc essaie de jeter un billet de banque dans le chapeau de Betinho. Poliment, Betinho refuse, et termine :
— Vous n'achetez que ce qui est à vendre. Ma poésie est un cadeau pour mon peuple.

Yara Nakahanda Monteiro | Angola |
La première nouvelle de Yara Nakahanda Monteiro Essa Dama Bate Bué! (2018) a été traduite dans plusieurs langues. Pour sa collection de poèmes Memórias, Aparições, Arritmias, elle a été récompensée par le prix littéraire portugais “Glória de Sant’Anna”, en 2022. Monteiro est également la co-autrice de deux courts métrages sur l’histoire coloniale de l’Angola et du Portugal, elle produit des podcasts et est conférencière invitée à propos des identités féministes Afro-européennes.