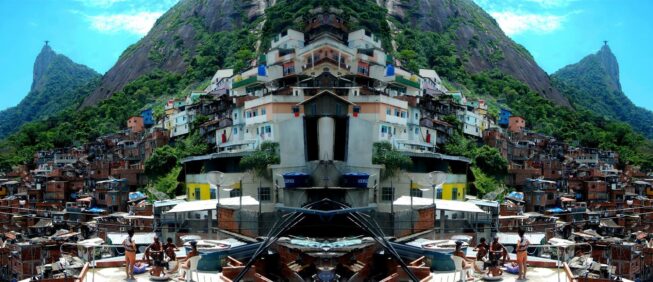Collectif Mujeres de Frente
Andrea Aguirre Salas et Elizabeth Pino réfléchissent sur l’action féministe antipenivrante du collectif créé à Quito
par Mario René Rodríguez Torres et Anderson Alves dos Santos
| Équateur |
12 de janvier de 2023
traduit par Déborah Spatz
Entre 2003 et 2004, il y a eu, en Équateur un cycle d’émeutes dans les prisons. En même temps que ces troubles, à l’extérieur des barreaux, une série de manifestations et de grèves menées par des mouvements sociaux a eu lieu, des organisations de travailleurs et de travailleuses, d’étudiants et d’étudiantes, de collectifs de femmes, d’indigènes, etc. L’État y a répondu par la violence. C’est dans ce contexte qu’est né Mujeres de Frente, un collectif qui travaille depuis 18 ans dans les prisons et à l’extérieur, en développant ce qu’elles appellent une “action féministe anti-pénitentiaire”. Dans l’interview qui suit, plusieurs membres de Mujeres de Frente parlent de l’histoire du collectif, des actions qu’elles y mènent, de la lecture qu’elles font de la récente crise carcérale en Équateur, ainsi que des alliances locales et internationales qui ont été mises en place.
Mario Rene : Pouvez-vous nous parler de la naissance du collectif Mujeres de Frente?
Mujeres de Frente : Nous sommes nées en 2004 dans la prison pour femmes de Quito, en tant que collectif organisé de femmes incarcérées et non incarcérées. En mai de cette année-là, d’intenses émeutes ont eu lieu et ont rendu public les problématiques des prisons, elles ont amené les personnes détenues, parmi lesquelles les femmes incarcérées dans la prison pour femmes de Quito, à interroger les citoyens sur l’acceptation générale et collective des conditions extrêmement précaires de leurs vies, de la prolongation toujours injuste de leurs condamnations, les mois, voire même les années, durant lesquels elles pouvaient rester en prison sans recevoir de sentence.
Un groupe de femmes non-détenues à Quito s’est senti touché et a commencé à se demander pourquoi les organisations sociales de gauches n’exprimaient d’aucune manière leur solidarité à l’égard de cette population pauvre, qui est marquée par l’asocialité. Ce dernier semblait distinct, distant, étranger, probablement antagonique à la population pauvre organisée. C’est ainsi qu’a eu lieu, en même temps que le processus d’émeutes, la rencontre, entre des femmes détenues et non-détenues dans la prison de Quito, ce qui impliquait également l’ouverture de débats publics qui interpellaient non seulement la société, par rapport à la cruauté liée à cette condition de vie acceptée de manière collective, généralisée au niveau sociale, mais également une interprétation spécifique de la gauche.
Qui est la population pauvre digne de participer et d’être reconnue comme faisant partie des processus révolutionnaires, et en même temps, comment être digne de vivre dans des conditions de vie humaines ? C’est ainsi qu’est née l’organisation qui était à l’époque un collectif de prise de conscience de soi féministe dans la prison pour femmes de Quito.
Quelles ont été les propositions initiales, les stratégies d’intervention à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, ainsi que les difficultés rencontrées durant les premières années de Mujeres de Frente et comment êtes vous parvenues à les surmonter ? Quelles activités développez-vous actuellement ?
Nos propositions initiales étaient liées à la possibilité de bâtir un féminisme fondé sur l’inégalité et la différence. Il nous semblait, à toutes les participantes de ce dialogue, que des propositions valables et intéressantes d’auto-organisation féministe en milieu bourgeois étaient nécessaires, mais pas suffisantes. Un féminisme antiraciste, anticapitaliste, dans un pays comme le nôtre, dans une région comme la nôtre, implique nécessairement des liens entre l’inégalité parmi les classes, des liens qui reconnaissent les traumatismes du racisme qui nous éloignent et qui construisent ainsi des séparations entre nous. C’est ainsi que Mujeres de Frente s’est construit, comme une voix anti-pénitentiaire élevée sur une base qui fonde la prison comme une scène, mais qui prétend aller toujours au-delà de la situation concrète de la prison.
Nos stratégies d’intervention au sein de la prison et à l’extérieur, impliquaient justement de soutenir dans la prison, des dialogues permanents qui ont commencé à prendre la forme d’échanges de prise de conscience féministe, d’éducation populaire, d’écriture collective. Ainsi est née notre Revue Sitiadas, qui, dès sa première année d’existence dans la prison, a été un mécanisme pour écrire en commun et nous apprendre à nous connaître et à comprendre ensemble. Et c’est dès l’intérieur que de toutes les actions hors de la prison étaient organisées, ce qui impliquait des liens de solidarité avec d’autres collectifs et organisations sociales, des manifestations publiques contre la punition, la visibilité publique de la situation particulière des femmes en prison.
De cette forme, nous nous sommes transformées nous-mêmes en nos relations : construire la confiance, le soin réciproque, la coopération dans l’échange de la reproduction est un processus qui accompagne notre voix publique anti-punitiviste de façon permanente, si bien qu’aujourd’hui nous sommes une organisation qui est composée de femmes détenues, anciennes détenues, membres de la famille de personnes emprisonnées, vendeuses ambulantes indépendantes, recycleuses de résidus urbains, travailleuses du sexe et femmes de ménages rémunérées à la journée, travailleuses et intellectuelles également rémunérées à la journée, professeures et étudiantes.
L’État punitif s’exprime de différentes forme, ce qui fait que Mujeres de Frente, qui, née à l’intérieur de la prison, est aujourd’hui une organisation qui, à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, agît contre la punition, contre l’État punitif dans et hors de la prison, contre la culture punitiviste. Nous sommes également une communauté de coopération et de soin entre les femmes, les enfants et les adolescents et adolescentes.
Entre la première et la deuxième édition de la revue que vous publiez, la Revue Sitiadas, une période de deux ans s’était passée (2004 - 2006), et puis, entre le deuxième et le troisième, il y a eu un intervalle de 14 ans (2006 - 2020). Pourquoi avez-vous eu besoin de tant de temps pour publier un troisième numéro ?
Il est important de dire que Sitiadas est un outil que nous avons décidé d’expérimenter pour pouvoir construire une voix publique et qui, en même temps, a été un exercice d’élaboration intime qui permet la reconnaissance des unes par les autres. Sitiadas a été une manière pour nous, en tant que collectif, d’expérimenter, entre autres, comme par exemple, les espaces d’éducation populaire dans les prisons — les processus d’imagination et de développement d’actions politiques de rue organisées au sein de la prison et exécutées en dehors, parfois, avec des camarades emprisonnées qui obtenaient des permissions, et toujours en dialogue avec d’autres organisations sociales, avec lesquelles, pendant ces années, de 2004 à 2010, nous avons construit un centre social et contre-culturel, la Casa Feminista de Rosa.
Et c’est ainsi que Sitiadas, entre autres expériences politiques de l’organisation a été publiée dans ses premières années. Puis, elle a cessé d’être publiée justement à cause de la concentration du collectif de façon organique sur d’autres expériences et expressions. Durant toutes ces années, nous avons expérimenter plusieurs manières de coopérer, plusieurs manières qui sont passées par un processus de construction d’écoles d’alphabétisation, de fin de l’école primaire, qui s’expriment aujourd’hui dans l’école de formation politique féministe et populaire. Cette école a été conçue justement dans le contexte de la grâce massive, de celles qu’on appelle les mules du trafic de drogue, qui a eu lieu en Équateur.
À cette époque, le gouvernement, apparemment de gauche, a promu et a, en fait, matérialisé la grâce pour les femmes appelées les mules du trafic de drogue, ce qui a eu pour conséquence la libération de plusieurs camarades de l’organisation. Dans ce contexte et toujours de façon organique, toujours en assemblée, nous avons identifié la transformation de notre situation en tant que collectivité, avec un nombre important de camarades anciennement incarcérées. C’était également un effort pour lutter contre la stigmatisation de la prison. Beaucoup de camarades anciennement détenues ne voulaient pas entretenir cette stigmatisation ou ce signe comme un marqueur central de leur militantisme ; elles voulaient se débarrasser de la prison. C’est ainsi que nous avons construit en 2009, l’école de conclusion de l’enseignement primaire et d’alphabétisation, qui réunissait des femmes des secteurs populaires non-détenues, avec qui nous avons également commencer à réfléchir à l’État punitif et avec qui nous avons également commencé à comprendre la manière dont l’État punitif opère au-delà des prisons, même si c’est au sein des prisons qu’on retrouve son expression la plus tenace, cruelle et brutale.
Durant ces années, Mujeres de Frente a construit un processus éducatif tourné vers l’intérieur. Ces durant ces années que nous avons consolidé ce que nous appelons aujourd’hui l’espace de Wawas, dans lequel il était nécessaire de mettre en place un espace de repas populaire pour que les enfants puissent déjeuner quotidiennement après l’école. Il fallait également consolider la possibilité de l’accompagnement scolaire dans des contextes dans lesquels les institutions publiques de l’éducation, de fait, l’éducation comme un droit, mais également aussi comme une punition. Et c’est ainsi que se sont développés les processus qui, dans le contexte de la pandémie, ont consolidé l’organisation comme un réseau de soutien à la survie.
Disons que la pandémie nous a obligées à reconnaître une situation authentique de vie et de mort, pas seulement causée par le virus, mais aussi par la précarité qui a rendu leurs conditions extrêmes à cause du confinement, des politiques d’interdiction du commerce de rue. Ainsi, le contexte de la pandémie s’est construit comme un contexte dans lequel nous devions consolider nos liens de coopération entre nous pour soutenir nos vies, celles de nos enfants et c’est ainsi que nous avons décidé de remettre sur pieds Sitiadas, comme une voix publique nécessaire dans un contexte et dans une conjoncture radicalement nouveaux.
Quel type d’importance a l’écriture conjointe que vous développez dans la revue pour vous ?
Sitiadas c’est, en pratique, un processus de coopération par l’écriture. Plusieurs camarades de l’organisation ne savent ni lire, ni écrire, même si c’est un droit que nous avons construit progressivement entre nous toutes, de sorte que la plupart d’entre nous savent lire et écrire. Beaucoup d’entre nous n’ont pas l’expérience de l’écriture justement à cause de la précarité de nos vies, à cause de la lapidation du droit à l’éducation, à l’amour, aux livres, etc., ainsi, écrire, c’est pour nous un exercice très difficile et qui exige que nous nous donnions la main. Sitiadas est un processus d’ouverture aux possibilités de l’écriture comme témoignage, et également de l’ouverture à de diverses expérimentations d’écriture collective.
En tant que résultat du processus de co-investigation soutenu durant des mois, en tant que résultat de dialogues qui ont eu lieu entre deux ou plusieurs camarades, également pendant des mois, en accompagnant la production d’un texte et l’édition de celui-ci, nous nous sommes toujours interrogées sur la possibilité de construire des perspectives qui ne nous sont pas propres, qui n’impliquent pas l’obligation de la perspective de certaines qui savent lire et écrire et d’autres qui ne le savent pas. C’est ainsi toujours une question tendue à propos de la possibilité de construction d’une voix collective, qui vient d’en bas, à partir des inégalités, en se reconnaissant et en étant toujours tournées vers les relations d’inégalités, comme celles de racisme qui nous traverse également. Et c’est pourquoi Sitiadas est un effort qui est méthodologiquement toujours multiple
Nous savons que récemment Mujeres de Frente s’est uni à d’autres collectifs et organisation d’Équateur pour former l’Alliance contre les Prisons. Pourriez-vous nous expliquer comme est née l’idée de l’Alliance et quels sont ses objectifs ?
C’est dans ce contexte et dans le cadre du premier massacre, en février 2021, qu’est née l’Alliance contre les Prisons. Une organisation d’organisations qui débat à propos des prisons en Équateur et qui tente de garantir une perspective abolitionniste et certaines demandes concrètes en faveur de la population actuellement incarcérée et de leurs familles. L’Alliance contre les Prisons réunit certaines institutions comme Caleidos, de caractère plus académique, des organisations de bases telles que Mujeres de frente et Corredores Migratorios, des organisations de Droits Humains, telles que En Red et Sedeat, et des personnes qui veulent, de droit, participer à ce processus. Il s’agit d’un espace pluriel et qui développe un projet de pouvoir de mise en commun des voix critiques et radicales qui ne tendent pas vers la réforme pénitentiaire, mais vers l’abolition.
Au cours de ses 18 ans d’existence, Mujeres de Frente a vécu différents moments dans le système pénitentiaire équatorien. L’un des moments les plus importants a eu lieu en 2014, quand a eu lieu la “modernisation” du système, menée par le gouvernement de l’époque du président Rafael Correia, le figure équatorienne du “cycle progressiste” latino-américain (Lula au Brésil, Kirchner en Argentine, Morales en Bolivie, etc.). Comme ce processus de “modernisation” a-t’il affecté la population privée de liberté et Mujeres de Frente ? Et comment en sommes-nous arrivés au massacres de 2021 ? Quelle est la responsabilité de l’État dans les massacres cités ? Et quelles solutions voyez-vous à la crise ?
Il est très important de distinguer ce que nous pourrions définir comme étant l’Ancien Régime Pénitentiaire de celui, qui, à partir de 2014, devrait être appelé le Nouveau Régime Pénitentiaire en Équateur. Les prisons les plus anciennes d’Équateur, évidemment, comme dans toute notre région, bien sûr, étaient des prisons qui se trouvaient normalement dans les villes. Elles étaient si précairement prises en charges par l’État, qu’elles ont dû être gérées, co-gérées par la population carcérale, leurs familles, les vendeurs ambulants, les agents pénitentiaires. C’est ainsi que les prisons en Équateur ont été des institutions aux murs très perméables.
À tel point que de nombreuses personnes de l’extérieur pouvait d’ailleurs faire des commandes aux commerçant à l’intérieur, comme par exemple des commandes de menuiserie, de couture. C’était ainsi dans l’Ancien Régime Pénitentiaire qui était vigueur dans la pratique jusqu’en 2014, même lorsque les transformations ont commencé à être remarquées en 2010, la prison a été traitée comme une institution, de façon injuste bien entendu, en vue de la composition de la population pénitentiaires. La prison est devenue une institution toujours destinée à la punition des secteurs les plus pauvres, racialisés, une institution qui précarise la vie, une nouvelle adversité ajoutée à l’adversité des secteurs populaires urbains, et aussi des migrants. Une institution qui s’est transformée de façon radicale également par la lutte contre les drogues, la déclaration de la lutte contre les drogues des États-Unis, une criminalisation qui a fondamentalement affectée ceux qui se trouvaient dans le trafic de drogue, dans le micro-trafic de drogue, une possibilité de vie, de la vie créant des entreprises d’échanges économiques non-violents, bien qu’illégaux, ce qui soit dit en passant, a impliqué à partir des années 1990, l’augmentation sans précédent de la population pénitentiaire féminine, dans l’histoire.
Il s’agissait donc d’institutions carcérales dont on ne peut faire d’apologies, auxquelles on doit penser comme étant des violences de l’État, et qui sont pourtant disputées, imprégnées par la pratique des secteurs populaires. Ceux qui entraient dans ces prisons se trouvaient dans une sorte de quartier populaire clos. Avec tous ces hommes, ces femmes et ces enfants, qui y circulaient, avec une série d’entreprises qui exigeaient un minimum de condition de paix interne, une série de liens sociaux qui, par définition, sont pacificateurs, même lorsque, évidemment, ils sont fondamentalement portés par les femmes… Cela été radicalement transformé par le projet, paradoxalement progressiste, du Nouveau Régime Pénitentiaire.
En fait, les prisons en Équateur, comme de nombreux projets du gouvernement progressiste, du Gouvernement de Révolution Citoyenne, impliquaient une importante entreprise de construction. C’était une base, celle des premières années de la Révolution Citoyenne avec un boom pétrolier, c’était une phase d’importants investissements de l’État dans des infrastructures routières et des infrastructures éducatives et c’était aussi une phase dans laquelle la construction d’un système carcéral monumental a été proposée. Ainsi, à partir de 2010, la construction de trois énormes unités pénitentiaires a été pensé, elles ont été construites loin des centres peuplés, conçues comme des régimes de sécurité maximale, dotées des plus récentes technologies de contrôle et idéalisées comme un projet qui, paradoxalement, serait socialiste : le contrôle de la vie quotidienne comme base de la réhabilitation.
Bien entendu, l’interrogation sur la manière dont la population carcérale pauvre devrait être réhabilitée, si elle se retrouverait dans la même situation de pauvreté radicale, après la libération, n’ont pas été abordées. En pratique, la mise en place de ce nouveau système de prisons étaient en réalité le développement d’un authentique système de torture. Durant l’année 2014, Mujeres de Frente a participé à la création du Comité des Membres de la Familles de Personnes Incarcérées, des membres de la familles, des proches des personnes incarcérées, comme on les appelle, qui regroupait la famille des personnes en prison qui souffraient effectivement de leur transfert vers ces nouvelles prisons comme de réelles situations de privation et de torture. De cette manière, les liens sociaux qui étaient établis avec l’extérieur, avec l’extérieur familial, l’extérieur économique, ont été rompus, générant ainsi des conditions d’isolement que nous comprenons avec beaucoup de clarté aujourd’hui, même si à l’époque, nous avions déjà prévenu, sont des conditions absolument violentes.
La population a dû porter l’uniforme, elle a été privée de style vestimentaire, la population a été privée du droit de posséder, par exemple, des photographies des membres de sa familles, de livres personnels, de journaux intimes, d’accéder à des moyens de communication, via la télévision, via des téléphones portables, etc. La torture qu’ont vécu ces personnes qui ont été transférées des anciennes vers les nouvelles prisons ces années-là, est indescriptible. Et nous l’avons vue, nous l’avons accompagnée, évidemment nous avons rendu visite à nos camarades dans les nouvelles prisons, évidemment, nous avons accompagné les familles, évidemment beaucoup d’entre nous étaient des proches de personnes incarcérées et nous pouvons affirmer que la cruauté avec laquelle le gouvernement agissait dans son rêve de contrôle était indescriptible. Et à la lumière de la perspective, des années plus tard, nous pouvons affirmer qu’ils ont effectivement créé les conditions d’un gouvernement maffieux des prisons.
Déjà en 2014, de nombreuses femmes avaient dénoncé le fait qu’elles étaient victimes d’extorsion. Et ici, j’insiste, c’était lié à la privation du lien social et également à l’impossibilité pour les personnes de l’extérieur de pouvoir soutenir ceux qui sont à l’intérieur, et que, évidemment, les personnes qui sont à l’intérieur pouvaient aider à soutenir sa famille. Des conditions de gouvernement sur la base de l’extorsion et des actions mafieuses ont été créées.
De plus, des conditions d’intensification de la violence sexiste se sont développées. Il est très important de comprendre que nous ne suggérons pas que les personnes violentes, les mafieux — comme si c’étaient un trait de naissance — gouvernent la prison. Nous disons que l’État a créé les conditions infrastructurelles et administratives dans les prisons pour que les pratiques violentes deviennent les règles de gouvernement interne.
Il est fondamental de comprendre comment la crise sanitaire a mené à l’intensification de la vie ultra-précaire au sein des prisons. Effectivement, la crise sanitaire en Équateur a provoqué des images d’abandon et de mort dans la population libre, bien sûr, la population des secteurs populaires libres, on ne parle même pas de la population incarcérée. La peur de la mort autogérée par la population incarcérée, isolée et ainsi, des conditions de précarisation, de déshumanisation de la vie auxquelles je fais référence sont devenues plus intenses encore.
C’est dans ce contexte qu’ont eu lieu les massacres dans les prisons. Disons jusqu’ici et seulement jusqu’ici, que cela nous permet d’affirmer que l’État est responsable de ces massacres. Pas seulement parce que la population pénitentiaire est sous sa garde. Et ainsi, dans le sens commun, leur mort, les délinquants à part entière, apparaît comme un phénomène pratiquement naturel, incontesté et incontestable. Nous devons également parler des instruments de ces morts, des machines comme des tronçonneuses, par exemple, et de l’existence aujourd’hui d’armes de gros calibres au sein des prisons. L’existence de ces machines fortement létales doit également devenir un objet d’interrogation.
Il est évident que grâce à la construction de ces énormes infrastructures, avec la consolidation de ce Nouveau Régime Pénitentiaire d’isolement radical et de haute sécurité, les conditions de ce que nous pouvons définir comme étant un État mafieux ont été créées. Il n’y a aucun doute sur cela, et en fait, nous avons des preuves qui ont été rendues publiques, que de hauts dirigeants des forces armées de ce pays, de la police de ce pays, ainsi que des gardiens de prisons, sont impliqués dans l’introduction d’armes de gros calibre dans les prisons, orchestrant ainsi les massacres, construisant ainsi des conditions de possibilité pour un gouvernement sécuritaire, qui normalise les états d’exception dans lesquels la population de l’extérieur admet vivre, et créant donc les conditions de possibilité à propos desquelles nous devons réfléchir sur des dynamiques d’accumulation illégale du capital.
Ainsi, nous pouvons affirmer, en nous concentrant sur la réflexion autour des armes de gros calibre, ces terribles outils de violence indicible, qui nous ont montré des images brutales, pas seulement de la mort mais aussi de la mort cruelle, nous pouvons affirmer que l’État est responsable de ces massacres en tant que constructeur de conditions pour que cette violence apparement auto-infligée soit une violence qui se développe en faveur de l’industrie des armes, qui se développe en faveur de la création de conditions pour l’accumulation illégale du capital, du gouvernement sécuritaire, à la fois à l’intérieur et l’extérieur des prisons aussi.
Pour nous, il est fondamental de mettre en place l’interrogation, toujours féministe, de cette problématique du point de vue des femmes. Les femmes incarcérées et qui ont un membre de leur famille détenu qui soutiennent les personnes en prisons, qui sont en majorité des femmes, en tant que mères, épouses, sœurs, etc. Les femmes incarcérées dans les pavillons féminins de ces immenses citées pénitentiaires, qui s’avèrent ainsi être mixtes, sont aujourd’hui des femmes exposées à des dynamiques de violence sexuelles qui se développent à travers la normalisation de la prostitution.
À partir de l’accès qu’on les commandants, c’est ainsi que les appellent la population carcérale, et bien sûr ceux autorisés par les premiers, ont sur les femmes de ces pavillons. Des femmes qui voient leurs conditions de vie être déterminées par la violence de sorte que, les nuits où l’alcool coule à flot, ces femmes doivent ressentir et endurer les coups de feux. De femmes dont le regard n’a pas de nom, dont l’invisibilité est absolue parce qu’elles ne constituent effectivement que la minorité de la population carcérale, qui est aujourd’hui d’environ 7 %. Des femmes exposées à des situations de contrôle, non seulement par les autorités, mais aussi par leurs propres paires masculins. Des femmes exposées à des situations de violence qui sont extralégales, illégales, et qui pourtant sont considérées comme étant établies pour les femmes, non-blanches, des femmes qui ont enfreint la loi ainsi que le mandat de la féminilité.
Il est essentiel de pouvoir voir, à partir de la perspective féministe, de la perpective des femmes et aussi des enfants, cette problématique pour pouvoir comprendre comment le Nouveau Régime Pénitentiaire précarise la vie des personnes emprisonnées ainsi que celles de leurs proches, leurs enfants, et qui, de cette façon vont se consolider comme étant la population pénitentiaire du futur. Nous devons donc comprendre que la prison a pour objectif de saisir la vie d’une population pénitentiaire qui dépasse de loin le nombre de détenus. Dans ce sens, il est urgent de penser à une pratique abolitionniste des prisons, une pratique abolitionniste des prisons non seulement pour faire naître un espoir pour les personnes emprisonnées actuellement, affectées par la prison, mais aussi pour tous ceux qui hors de la prison constate comment la sécurité est la clé du gouvernement leurs vies.

Mujeres de Frente | ÉQUATEUR |

Mario René Rodríguez Torres | Colombie |
Professeur de lettres à l’Université fédérale d’intégration latino-américaine (UNILA). Il est coordinateur adjoint du droit à la poésie et coordonnateur du blog "A escrita e o fora", consacré à l’écriture littéraire produite dans les prisons d’Amérique latine.
mario.torres@unila.edu.br
Anderson Alves dos Santos | BRÉSIL |
Étudiant en philosophie et contributeur au projet d’extension d’UNILA Droit à la poésie.