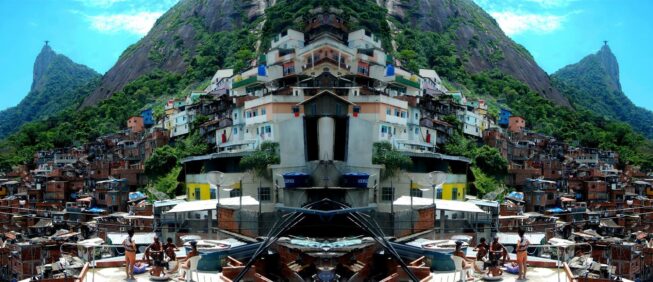Juliana Borges
Pour une démocratie de l’abolition que conteste les hiérarchies et renforce les processus communautaires
par Mario René Rodríguez Torres et Cristiane Checchia
| Brésil |
juillet 2022
traduit par Déborah Spatz
Concernant l’invisibilité de la question carcérale au sein de la société brésilienne : pourquoi est-ce si difficile de surmonter une vision déshumanisante des personnes incarcérées et si simple de naturaliser leur souffrance ?
En général, nous pensons et nous vendons une idée pacifique de la société brésilienne, une société dans laquelle tous les groupes vivent en harmonie. C’est une idée remise en question, depuis quelques décennies, par d’importants penseurs brésiliens et brésiliennes, comme Abdias do Nascimento et Florestan Fernandes, ainsi que par des féministes noires notoires, à propos du mythe de la démocratie raciale. Il y a une autre formulation que j’apprécie beaucoup, de la philosophe Marilena Chauí, qui met en évidence la violence comme un mythe fonctionnel de la société brésilienne. Vous voyez, cette idée appelée Brésil est née des invasions et des violences brutales contre les peuples autochtones et, postérieurement, par le séquestre de personnes africaines pour qu’elles deviennent la main d’œuvre réduite en esclavage dans le pays.
Ce que je veux dire par là, c’est que la violence est naturalisée dans nos relations, qu’elles soient en exécution macro, de forme institutionnelle, ou qu’elles se trouvent dans les micro-agressions quotidiennes. Et, si un jour, la figure déshumanisée a été celle de l’esclavisé, avec les transformations du racisme — qui perdure encore et organise les inégalités sociales —, la principale figure déshumanisée est aujourd’hui celle de la personne en situation carcérale.
Même si, sur le papier, le système carcéral a une fonction de resocialisation, le sens commun, les habitudes et les dynamiques sociales quotidiennes exécutent une politique de vengeance, traversée également par la correction qui, en réalité, voit ces individus comme des “incorrigibles”. C’est dans cette perspective que se base, se diffuse et se reproduit la pensée qui dit que les personnes emprisonnées devraient souffrir.
Même si, sur le papier, le système carcéral a une fonction de resocialisation, le sens commun, les habitudes et les dynamiques sociales quotidiennes exécutent une politique de vengeance
La penseuse Carla Akotirene, dans son ouvrage Ó paí, prezada! 1Editora Pólen, 2020, dans lequel elle aborde la situation carcérale des femmes dans la ville de Salvador, nous interpelle par cette idée de souffrance comme étant la racine de l’emprisonnement en nous montrant quelque chose de simple : l’étymologie de “pénitencier”, lié à la pénitence, à un lieu d’expiation.
Toutes ces questions s’articulent idéologiquement pour que la société comme un tout, pense que la prison ne nous concerne pas tous comme un tout, et que, ainsi, les non-désirés ne méritent pas les droits que nous tous avons. De cette façon, une structure et une dynamique de la naturalisation de la violence et de la souffrance par rapport aux personnes en situation carcérale se perpétue.
Comment analysez-vous l’emprisonnement des femmes au Brésil ? Pourquoi le rythme d’incarcération féminin a-t’il autant augmenté ces dernières années ? Quels sont les effets sociaux de cela ?
Nous constatons une augmentation vertigineuse de l’incarcération féminine dans le pays. Dans leur majorité, les femmes en situation carcérale sont mères, cheffe de famille et n’ont pas terminé le lycée. En dialogue avec les formulations de la philosophe Angela Davis, nous percevons que les prisons sont le reflet de la précarité dans notre société. Il ne s’agit pas d’un projet qui a échoué. Avec les appareils de contrôle et d’extermination, les sociétés, en général, traitent les prisons comme “les dépôts des détritus du capitalisme”. En d’autres termes, tout ce qui n’est pas désiré doit être incorporé par la dynamique de contrôle et de violence sur nos corps.
Les femmes sont de plus en plus souvent à la tête des familles, mais cela n’est pas accompagné de politiques d’emplois décents pour elles. En général, quand on parle de production d’emploi et de salaire, nous faisons références aux emplois fortement précaires, ceux dans le domaine du care et d’emplois reproductifs, répétitifs et hautement aliénants Si dans n’importe quel scénario de crise, les premières personnes affectées sont les femmes et si elles ont toujours plus de responsabilités pour s’occuper de leur famille, comment pouvons nous croire que ces femmes peuvent garantir la survie de la famille ?
L’économie et le marché des drogues ont une dynamique de fonctionnement très ressemblante à celle d’autres marchés, quand on parle du débat sur l’inégalité des sexes. Les femmes, en général, travaillent dans la vente, comme employées de base et ainsi, elles occupent les postes et les situations les plus précaires et les plus vulnérables. La conséquence de cela est que, avec le développement des ressources et des politiques de luttes contre les drogues, ces femmes, qui sont en premières lignes dans le travail, seront les premières à souffrir de cette violence, que ce soit par l’augmentation du nombre de femmes incarcérées ou par la perte de leur compagnon, de leurs enfants ou des membres de leur famille.
On parle d’une plus grande déstructuration dans les familles noires et périphériques et dans le maintient d’un cycle de violence et d’exclusion socio-raciales
Les effets sociaux sont immenses : des familles qui perdent leur pilier et moyen de subsistance, des femmes séparées de leurs enfants et qui font d’ailleurs face à de plus lourdes peines pour les crimes corrélées, par rapport aux hommes, par le poids du patriarcat dans les décisions.
On parle, ainsi, d’une plus grande déstructuration dans les familles noires et périphériques et dans le maintient d’un cycle de violence et d’exclusion socio-raciales.
Vous présentez Carceral Capitalism2Capitalismo Carcerário, un ouvrage de Jackie Wang, publié aux éditions Igrá Kniga. En établissant un parallèle avec l’incarcération aux Etats-Unis, quelles caractéristiques l’éloignent et le rapprochent de l’incarcération au Brésil ? L’analyse de Jackie Wang peut-elle contribuer à ce que nous pensions à ce parallèle ?
Je suis très reconnaissante de l’invitation qui m’a été faite de pouvoir écrire la préface du livre de Jackie Wang. Ses formulations à propos de l’incarcération sont fondamentales, justement parce qu’elles sont posées dans une lecture durant laquelle on ne peut pas penser l’incarcération sans penser au capitalisme et au racisme. Lorsqu’on parle de prisons, on parle d’une gestion de groupes socio-raciaux, un type de gestion fondamentales pour le fonctionnement du capitalisme et l’extraction de plus de valeur.
On parle de la précarisation, d’une relation historique entre servitude et esclavage et de la constitution de cet appareil pour la radicalisation et la hiérarchisation de groupes racialisés. En analysant cette perspective par la voie d’un complexe carcéral industriel, on parle également de gestion de main d’œuvre précaire.
Les parallèles sont nombreux entre le Brésil et les États-Unis. D’abord, parce que nous sommes dans l’un des pays qui incarcère le plus en nombre absolu, les États-Unis se trouvant en premier sur la liste et nous nous trouvons tout de suite après, en troisième position. Mais le plus important à relever est que, même en proportion, le Brésil n’est pas en position confortable quand il s’agît de la population carcérale, occupant la 26e place.
En d’autres termes, on parle d’une large construction sociale basée sur le punitivisme. Et ce punitivisme s’exprime dans ces deux sociétés à partir des groupes sélectionnés par l’action pénalisante de l’État : les noirs, les autochtones et les migrants. La guerre contre les drogues est un autre point de connexion. Le Brésil, contrairement à ce que nous pouvons imaginer, a été l’un des premiers pays à solliciter la criminalisation de l’utilisation des substances comme le cannabis dans les organismes internationaux, avec l’argument et “la peur blanche” qui disaient que l’utilisation du cannabis serait liée à une certaine vengeance des Noirs par rapport à l’esclavage.
Les États-Unis sont responsables de la structuration et l’exploration de “la guerre contre les drogues”, durant une période historique fondamentale pour le pays, alors que les questions des droits civils et de l’égalité et de l’équité sociale et raciale étaient déjà avancées.
Ce qui est appelée la guerre contre les drogues a, en réalité, comme contexte idéologique, le contrôle et la criminalisation de certaines cultures et certains groupes ethniques et raciaux. Il est donc vrai que la crise des opioïdes à laquelle les États-Unis font face actuellement n’est pas contrée par une politique dure et policière, cependant elle est considérée comme un problème de santé publique. Tout comme là-bas, la question de la consommation problématique de substances comme le crack, ici, n’est pas vue comme une question de santé, mais comme une question policière. Et si nous jetons un regard démographique sur les utilisateurs majoritaires d’opioïdes et de crack, la raison pour laquelle des chemins différents sont choisis devient évidente, pour que, au fond, on parle d’un débat sur l’utilisation de substances controlées ou non et de forme abusive par les personnes.
Pour finir, une autre conversation sans trop de parallèle encore, mais non moins importante, et qui demande toute notre attention, est celle de la légalisation du cannabis. Aux États-Unis, s’agissant d’un débat qui a lieu de forme décentralisée, à partir des états, il existe plusieurs législations. Nous voyons une organisation de groupes dominants et du capital financier en dispute à propos des modèles de légalisation.Une législation sans réparation ne doit pas nous intéresser ou alors nous défendrons le maintien de la concentration de la richesse dans les mains de 1 % au détriment des 99 % affectés par la violence de la prohibition depuis si longtemps
Il y a des états dans lesquels les personnes sortent du système pénitencier, qui ont été emprisonnées pour trafic de drogue, et a qui on interdit l’accès au marché du travail; dans d’autres, le modèle économique pour la participation du marché cannabique rend impossible l’intégration de groupes qui ont été affectés historiquement par le prohibitionnisme. Une législation sans réparation ne doit pas nous intéresser ou alors nous défendrons le maintien de la concentration de la richesse dans les mains de 1 % au détriment des 99 % affectés par la violence de la prohibition depuis si longtemps.
Je pourrais développer bien davantage, ici, les possibles parallèles entre le Brésil et les États-Unis sur le thème thème de l’incarcération, mais je laisse cette invitation pour que vous lisiez la préface du livre ainsi que le livre.
Nous savons que des actions pour l’amélioration des conditions d’incarcération sont palliatives et incapables de résoudre la question prisonnière à court terme. Malgré cela, nous avons des exemples d’actions qui concernent des personnes incarcérées dans un processus de dialogue qui montrent, au moins, des chemins possibles vers des solutions pratiques. Comment voyez-vous la puissance des sujets dans le processus de confrontation à des conditions inhumaines et dégradantes ?
Je pense qu’il est fondamental. Je ne suis pas une enthousiaste de l’idée du “ plus c’est pire, mieux c’est " pour expliciter les contradictions et les dynamiques violentes dans les prisons. Avant toute choses, on parle de personnes, de vies, de familles, d’enfants, de pères, de mères, de nièces, de sœurs. Nous ne pouvons pas, en parlant à partir de nos maisons confortables, être intransigeants envers la défense de l’abolition des prisons sans penser qu’il y a des personnes qui survivent à cet enfer et qui ont des demandes urgentes. Il s’agît de vies et de conditions minimums de dignité. En même temps, je ne crois pas au discours qui dit que pour s’occuper de la super incarcération et du surpeuplement, nous devons défendre la construction de plus d’unités d’incarcération.
Selon un rapport du Département de Politique Pénitentiaires du Gouvernement Fédéral, ces 16 dernières années, il y a eu une intense extension des unités d’incarcération : 4 constructions prisonnières sur 10 ont, au maximum, 16 ans d’existence. Le surpeuplement sera résolu avec la désincarcération, que l’on pourrait commencer avec au moins 25 % des personnes en situation d’incarcération emprisonnées de façon provisoire, en d’autres termes, des personnes qui sont en attente de jugement.
Le surpeuplement sera résolu avec la désincarcération, que l’on pourrait commencer avec au moins 25 % des personnes en situation d’incarcération emprisonnées de façon provisoireIl y a des actions qui pourraient être réalisées simplement par le respect et l’application de la Loi d’Exécution des Peines. Comme par exemple, l’accès au travail et à l’éducation. Moins de 30 % des personnes en situations d’incarcération étudient et/ou travaillent. Et c’est un droit. En plus de cela, beaucoup de femmes incarcérées sont mères d’enfants mineurs, et ainsi, pourraient purger leur peine à domicile.
Il y a également la question des installations d’unités pénitentiaires totalement insalubres. Malgré qu’il s’agisse d’un obligation de l’État, ce sont les familles des personnes incarcérées qui garantissent les produits d’hygiène fondamentaux et une alimentation avec un minimum de qualité. Le suivi médico-hospitalier, le suivi gynécologique, l’accès à du papier toilette et à des protections hygiéniques. Ce sont des questions fondamentales de dignité quotidiennes et niées de manière répétitives aux personnes en situation d’incarcération.
À partir des conditions socio-politiques contemporaines, est-il possible de penser à des pratiques alternatives à la prison ?
Je pense que c’est non seulement possible mais surtout nécessaire. On a déjà prouvé qu’il n’y a pas de lien entre l’augmentation des prisons et la diminution de la criminalité. Ainsi, pourquoi continuons-nous à défendre une appareil comme celui-là ? Si l’argument qui est de dire que les prisons sont des espaces de resocialisation, pourquoi acceptons-nous des conditions dégradantes et qui déshumanisent pour les personnes en situation d’incarcération ? Pourquoi trouvons nous cohérent de violenter des personnes et ensuite, vouloir qu’elles ressortent humanisées d’un espace comme celui-là, en voulant nous prendre dans leurs bras ? Quelles sont les conditions sociales que nous donnons aux personnes lorsqu’elles sortent d’incarcération ?
La prison, en plus d’être un espace de violence brutale et de déshumanisation, est un espace de marginalisation définitive, puisque le stéréotype que ces personnes portent, même après avoir purgé leur peine, est continu. Nous devons, de façon urgente, penser et appliquer toujours plus d’espaces alternatifs, constituer des espaces civils de médiation de conflits, garantir les droits sociaux fondamentaux et de dignité.La prison, en plus d’être un espace de violence brutale et de déshumanisation, est un espace de marginalisation définitive, puisque le stéréotype que ces personnes portent, même après avoir purgé leur peine, est continu
La société sera toujours conflictuelle, parce qu’on parle d’intérêts divers, de désirs, de perspectives, d’histoires, de formes d’existence et de pensées. Mais, il revient à nous de penser à des solutions des médiations qui soient réparatrices et restauratrices du lien et de la dynamique de vie en société.
Cela ne sert à rien de marginaliser un individu pour que lui-même bâtisse l’empathie et le sens de la communauté. De plus, si on parle d’une société égalitaire, avec de la justice sociale, comment continuer à défendre un espace qui sert à contrôler et à exterminer des groupes sociaux ? Nous devons, de façon urgente, avancer vers des propositions et de dynamiques pour une démocratie de l’abolition, dans laquelle les hiérarchies sont contestées et les processus communautaires tournés vers le soin et la restauration des liens, la cible de l’action.

Juliana Borges | Brésil |
Écrivain, libraire et chercheur en relations raciales, politique criminelle et sécurité publique. Conseillère à la Plateforme brésilienne de politique des drogues et conseillère de plaidoyer de l’Initiative noire pour une nouvelle politique sur les drogues. Associée propriétaire de HG Publications. Féministe antipunitiviste et antiprohibitionniste. Auteur du livre Encarceramento em massa (Feminismos Plurais, Jandaíra) et Prisões: espelhos de nós (Todavia). Elle a été secrétaire adjointe aux politiques pour les femmes et conseillère spéciale au Secrétariat du Gouvernement Municipal de la Mairie de São Paulo. Étudie la sécurité publique (FMU).

Cristiane Checchia | Brésil |
Historienne et professeur de littérature latino-américaine à UNILA. Coordinatrice du projet Direito à poesia (Droit à la poésie), qui réalise d’ateliers littéraires dans les prisons de Foz do Iguaçu, au Sud du Brésil. www.direitoapoesia.com.brtrad
cristiane.checchia@unila.edu.br
Mario René Rodríguez Torres | Colombie |
Professeur de lettres à l’Université fédérale d’intégration latino-américaine (UNILA). Il est coordinateur adjoint du droit à la poésie et coordonnateur du blog "A escrita e o fora", consacré à l’écriture littéraire produite dans les prisons d’Amérique latine.
mario.torres@unila.edu.br