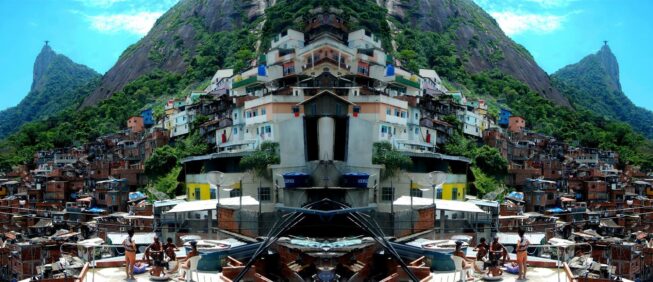"Pour un monde sans prisons" - interviews de militants du Front pour le Désarchement du Paraná
L’importance des mouvements collectifs dans la lutte quotidienne pour le désenclavement
par Layra Rodrigues et Jhey Rodrigues
| Brésil |
avril 2023
La réalité du système carcéral est également connue comme étant moins un échec dans la gestion et plus comme constitutive de son caractère. Les réalités et le caractère des mouvements qui lui font face, pas tellement. C’est une perspective de ces réalités que cherchaient Layra Rodrigues et Jhey Rodrigues, étudiantes participantes du projet Direito à Poésia [Droit à la Poésie], de l’Université Fédérale de l’Intégration, dans les entrevues qu’elles ont menées pendant la Rencontre d’État du Front pour la Désincarcération de l’état de Parana.
L’évènement est, entre autres choses, une célébration des efforts qui ont résulté en la création du Front pour la Désincarcération du Parana, qui suit de très près de nombreux fronts d’états inspirés par la publication dans le Programme National pour la Désincarcération, de 2013. La réversion de l’incarcération en masse, axe qui oriente les dix directrices qui composent le Programme, est également l’horizon qu’ont pour objectif les collectifs et les initiatives anti-carcérale qui occupent cet espace d’articulation entre le 26 mars et le 22 avril 2022.
Tout au long de ces quatre semaines, Layra et Jhey ont entendu Lucas Duarte, coordinateur de la Pastorale Carcérale de Curitiba, militant du Front pour la Désincarcération du Parana et l’un des organisateurs de la rencontre ; Márcia Tillmann, travaillant dans une cantine, membre du Collectif des Familles et Amis de Personnes Détenues de Foz do Iguacu et sa Région, ancienne détenue et membre de la famille d’une personne privée de liberté et Raissa Melo, journaliste, militante du Front pour la Désincarcération du Parana et l’une des organisatrices de la rencontre, ancienne détenue également. Les trois ont partagé, dans les entrevues à suivre, de nombreuses portions de leur histoire collective des mouvements auxquels ils participent, mais également de leur propre vie au sein de ces mouvements.
entrevue de Lucas Duarte, Coordinateur de la Pastorale Carcérale de Curitiba
comment est né le Front pour la Désincarcération ? Qu’est-ce qui a pu être atteint à partir de cette articulation ?
Le Front du Parana est une construction récente. Il faut peut-être, en parlant de lui, parler du Programme National pour la Désincarcération, qui est articulé depuis 2013 au moins, à partir de la Pastorale Carcérale et de mouvements, comme celui des Mères du mois de Mai.
Il ne s’agit pas seulement de parler de ce qu’il doit y avoir dans l’éducation mais plutôt de diagnostiquer, et, avec le diagnostique du fait que la prison est un mal inutile, une souffrance inutile, nous avons pensé à dix actions qui pourraient atténuer cette souffrance, et qui sait, la vaincre.
À partir du Programme, les organisations qui la composent ont commencé à remarquer l’importance de s’organiser également dans les territoires — les états, les villes, les quartiers — dans lesquels ils agissent. Les Fronts pour la Désincarcérations sont ainsi apparus, d’abord à Rio de Janeiro, puis à São Paulo, dans l’état de Minas Gerais. Dans la construction du Front, plusieurs organisations qui travaillent avec les Droits Humains vont s’aligner et unis leurs forces : l’université, la défense, les mouvements d’église, les pastorales, les mouvements des familles et les personnes détenues.
Durant la Pandémie, nous avons construit le Front pour la Désincarcération au Parana, en commençant avec des familles. Le lancement de ce programme, le 2 octobre 2020, a eu lieu un jour symbolique, celui qui marque le massacre de la prison de Carandiru, dans laquelle au moins 111 personnes ont été assassinées par l’État [en 1992, à São Paulo].
Malgré l’impossibilité d’accéder au système, l’information, les membres des familles eux-mêmes ont compris qu’il fallait s’organiser d’une façon ou d’une autre. Ce n’est qu’à ce moment-là que la pastorale, comme c’est le rôle de notre activité de soutien aux organisations populaires, a montré ce qui était en train d’être construit dans les autres fronts. Et plusieurs personnes se sont jointes à nous. La plus grandes récompenses de tout cela, a été l’importance des familles dans l’élaboration des dénonciations et dans le dialogue avec les autorités. Nous avons tenté de créer cela : personne ne représente personne dans cet espace, chaque collectif doit s’organiser pour expliquer ses demandes et exiger des solutions.
Personne ne représente personne dans cet espace, chaque collectif doit s’organiser pour expliquer ses demandes et exiger des solutions.
Peut-être en sommes nous arrivés, à l’heure actuelle, à cet état des choses à cause de politiques paternalistes, dans lesquelles l’idée est de ne pas faire avec, mais de faire pour. Le Père Julio, de São Paulo, insiste beaucoup sur le fait que nous ne pouvons pas travailler pour les familles, pour les détenus. Nous travaillons avec, nous construisons ensemble, en partageant. C’est un projet plus lent, qui prend plus de temps, encore plus à cause de la pandémie qui rendait impossible notre présence en « face-à-face ».
Par notre présence, nous parvenons à construire des choses plus profondes. Cependant, il faut comprendre le temps de chacun et de la politique aussi. Parfois, c’est une chose urgente, que nous n’arrivons pas à mettre en avant parce que nous n’avons pas une structure suffisante pour y faire face.
Comment voyez-vous l’importance du Collectif des amis et Familles à Foz do Iguaçu ?
Je suis proche du collectif, j’alimente le collectif, je laisse les personnes y prendre leur place et je me réjouis parce que parvenir à avoir au moins trois personnes de Foz do Iguaçu avec nous, c’est une victoire. Je voudrais qu’il y ait des personnes de Londrina, de Maringá… Mais je pense qu’il est important pour cette lutte que les familles s’organisent à travers des collectifs, et que lorsqu’on parle de collectif, il ne s’agit pas d’une question bureaucratique, une entreprise, non ; mais plutôt des personnes qui veulent se rassembler parce qu’elles se rendent compte de la souffrance inutile que le système carcéral provoque et c’est cela : l’université et la défense qui font ce qui doit être fait, unissant leurs forces avec les familles, pour qu’ils sachent aussi que cela existe.
En fait, nous disons toujours que les institutions sont en faillite, mais on ne parvient pas à créer des institutions, participer aux institutions de sorte qu’elles puissent nous servir. Comme on dit que c’est l’état démocratique de droit, je pense donc qu’il est très important que les familles, mais pas seulement, toute personne qui s’indigne de cela, également, doit se mobiliser et doit faire partie de tout cela.
L’un des problèmes que je voie, et je ne veux pas être polémique ou trop divaguer, mais l’un des problèmes de l’idée de la place de la parole est celui-ci : au lieu de mobiliser des personnes, il finit par les démobiliser. « Ma parole n’a pas de place ici, je ne peux pas participer. » ; la personne s’annule et ne reste que dans son monde, avec ses problèmes subjectifs. On ne doit pas prendre les problèmes des autres, mais plutôt remarquer les douleurs de l’autre comme étant les nôtres.
Je pense toujours à cela comme étant une question de solidarité parce qu’on ne peut pas être affecté directement par quelque chose, mais indirectement, c’est un problème commun à nous tous. On peut être solidaire à la douleur d’une personne qui est différente, puisque, d’une forme ou d’une autre, nous faisons tous face à quelque chose, que nous soyons des femmes, des personnes pauvres, en tant qu’hommes, en tant que personne noire… il y a toujours quelque chose. Récemment, la pastorale a lancé le rapport Por um mundo sem cárceres: a urgência do desencarceramento [Pour un monde sans prisons : l’urgence de la désincarcération]. Que pouvez-vous nous en dire ?
La prison n’est pas un monde à part du nôtre, le monde du crime, cela n’existe pas, le monde des prisons, ce n’existe pas. C’est notre monde à nous.
Cette publication collective de Pastorale Carcérale développe ce sur quoi nous instituons : il ne suffit pas de parler d’abolitionnisme, il faut réenchanter notre imaginaire. Cela n’a rien à voir avec les super-héros ou la littérature fantastique. C’est possible, plusieurs pratiques nous démontrent aujourd’hui à quel point la police et l’incarcération sont superflues.
Le texte que j’ai écrit dans cette publication parle de la manière dont la communauté a détruit une prison — elle l’a détruite avec ses propres mains, avec des marteaux. En termes pratiques, nous n’avons pas besoin de cette… « Violence rebelle ». Il est tout à fait possible de rendre ces institutions obsolètes, comme le dit le texte d’Angela Davis. Ce qui a pu servir à d’autres générations, ne sert plus à la nôtre. Nous avons besoin d’une autre structure, un autre moyen, une autre médiation parce que celle que nous avons prend la vie de nombreuses personnes. Cette publication nous développe un peu ce mouvement de montrer que c’est possible, à travers des données, le débat académique, par rapport à la question politique des mouvements sociaux. Nous tentons de ne pas séparer le débat, la construction et la pratique politique.
Mon étude de master a porté sur l’incarcération, notre lutte et à quel point la théologie peut contribuer à ce réenchantement de l’imaginaire des personnes, surtout parce que la majorité des discours religieux endossent le discours punitiviste, cette forme dans laquelle le sujet est coupable, le sujet est criminel. Même la Théologie de la Libération, un courant duquel je fais partie, ne s’est pas penché sur l’incarcération ; il s’agit d’un mouvement récent. On y parle de la torture, des prisonniers politiques torturés, beaucoup de chansons ont été chantées dans les communautés parlant de l’incarcération. Mais penser au fait que nous n’avons pas besoin de prison, personne ne l’a fait.
J’ai l’habitude de dire que la Théorie de Libération a pour maxime le choix préférentiel pour les pauvres et je pense beaucoup au choix préférentiel de rébellion des pauvres.
Les familles sont indignées, et nous leur demandons de garder le calme, mais personne ne demande jamais à la justice d’être calme, on ne demande jamais cela à la police. J’ai commencé à choisir leur rébellion, en les comprenant et à faire émerger quelque chose de nouveau de cette rébellion. C’est de là que vient la créativité des mouvements sociaux : de la rébellion, de l’indignation.
Parfois, les chercheurs, les agents pastoraux, ou même nous, lorsque nous atteignons une position importante dans la société civile, nous nous positions en tant que médiateurs de conflits. Les familles sont indignées, et nous leur demandons de garder le calme, mais personne ne demande jamais à la justice d’être calme, on ne demande jamais cela à la police. J’ai commencé à choisir leur rébellion, en les comprenant et à faire émerger quelque chose de nouveau de cette rébellion. C’est de là que vient la créativité des mouvements sociaux : de la rébellion, de l’indignation.
entrevue de Márcia Tillmann, travaillant dans une cantine, membre du Collectif des Familles et Amis de Personnes Détenues de Foz do Iguacu et sa Région
Quelle est votre relation avec la prison et avec le Front Pour la Désincarcération ?
J’ai, moi aussi, été détenue. J’en suis sortie, et aujourd’hui, je rends visite à mon mari, qui est en prison depuis 11 ans déjà. J’ai connu le Front grâce à une amie, ancienne détenue également. C’était au moment de la pandémie. À Foz, nous étions en grandes difficultés, sans nouvelles de nos familles, sans rien savoir. Je n’avais pas droit aux visites virtuelles, il n’y avait pas de visite en présentiel, il n’y avait rien. Une amie à moi connaissait les membres du Front de Curitiba et en était une animatrice, elle m’a intégré au groupe. Ils m’ont aidé à réussir à avoir droit aux visites virtuelles, à avoir des nouvelles des familles. Ils aident également lorsqu’un abus d’autorité a lieu, une agression… Ils donnent les bonnes orientations, indiquent où l’on peut chercher de l’aide.
À votre avis, quelle est l’importance de l’articulation du collectif des amis et familles de personnes détenues à Foz do Iguaçu ?
Lorsque nous avons commencé, c’était très important parce que nous nous sommes fortement unis. Toutes les familles qui étaient présentes dans le groupe du collectif de famille, nous avons commencé à lutter pour nos droits. Ainsi, nous sommes parvenus à organiser des réunions durant lesquelles le directeur était avec nous, pour nous donner des explications. Ensuite, il a disparu.
Plus tard, nous avons tenté d’organiser une autre réunion avec lui, mais nous n’y sommes pas parvenus. Mais le collectif est bon, puisque nous sommes les familles, il y a toujours une personne qui ne sait pas quel vêtement peut être porté pour entrer, quel type de chaussures, les jours de visites. Pour recevoir les informations de la part de la prison, c’est comme pour les lettres, on ne les reçoit que grâce à une assistante sociale qui s’occupe de tout.
Donc, parfois, elle répond à toutes les demandes que la famille peut avoir. Et nous, les membres de la famille nous donnons les bonnes instructions concernant les jours de visite, ce qui peut être mis dans les sacs, ce qui n’est pas autorisé à entrer, les bons vêtements pour entrer durant les visites. C’est de tout cela dont nous parlons parce qu’il y a toujours quelqu’un qui cherche et obtient l’information et la repasse, tout cela, à travers le collectif.
On y a énormément de soutien. Comme pour les téléphones portables, on reçoit beaucoup de messages audio de mère désespérées parce que leur fils est malade. Il y a une Dame, Dona Madalena, son fils a la tuberculose. Elle envoie donc souvent des messages pour nous demander de l’aide. On discute beaucoup pour savoir où sont les fils des mères qui n’ont pas de nouvelles. Parfois nous-mêmes envoyons des mails pour les visites des femmes qui n’y arrivent pas, parce que ça fait un an qu’ils n’ont pas vu leur famille.
C’est de tout cela dont nous parlons parce qu’il y a toujours quelqu’un qui cherche et obtient l’information et la repasse, tout cela, à travers le collectif.
Il y en a toujours une qui vient voir l’autre pour lui demander de l’aide. À partir de là, elle lui dit de venir vers nous et nous la mettons directement dans le groupe, c’est comme ça que cela se passe. Par exemple, une personne vient vers vous et vous demande de l’aide, n’importe quel type d’aide, parfois, vous ne savez pas comment répondre et donc, vous venez me voir en me demandant de l’intégrer dans le groupe. On l’y ajoute et c’est là qu’elle peut obtenir des réponses à ses questions.
D’après votre expérience, comme l’incarcération affecte-t-elle la personne privée de liberté ? Et sa famille ?
Je dis toujours que la famille souffre, peut-être même plus que le détenu. Lorsqu’on sait que quelqu’un de notre famille se fait battre, qu’il n’a pas à manger, qu’il est en isolement, on veut faire quelque chose, mais on ne peut pas, on est empêché de faire quoi que ce soit. Et dans ce cas, c’est très compliqué.
Je dis toujours que la famille souffre, même plus que le détenu. Lorsqu’on sait que quelqu’un de notre famille se fait battre, qu’il n’a pas à manger, qu’il est en isolement, on veut faire quelque chose, mais on ne peut pas.
Les médias disent que le prisonnier suit des études, que le prisonnier a un travail. Le prisonnier ne suit pas d’études, le prisonnier n’a pas de travail. Il y a quelques postes, mais ils sont très peu nombreux comparés à la quantité de prisonniers. Il devrait y avoir plus de travail. Il devrait y avoir quelque chose pour les resocialiser. Comme je l’ai dit aujourd’hui : on en sort avec beaucoup de haine. Ou on est très fort dans sa tête et on se concentre sur ce que l’on veut, sur changer notre vie, ou alors…
Ils disent toujours : « Mais tu viens de sortir et tu es déjà de retour ? Ça t’a plu ? ». Ce n’est pas qu’on a aimé… Si vous commencez réellement à étudier sur le thème de la prison, vous allez voir que beaucoup sont dépendants à la drogue, qu’ils ne devraient pas être en prison, et plutôt dans une clinique de désintoxication. Mais où y en a-t-il dans le Parana ? Ils les envoient en prison. Et en prison, en réalité, on n’arrêtera jamais de consommer de la drogue…
Après ma sortie de prison, j’ai eu une audience avec un juge, je lui ai dit : « Vous voulez savoir où j’ai fumé ma première cigarette ? En prison. Vous voulez savoir où j’ai sniffé mon premier rail de cocaïne ? En prison. Vous voulez savoir où j’ai fumé de l’herbe pour la première fois ? En prison. » Et il a dit : « Mais comment ? Comment cela entrait ? » Et j’ai répondu : « Demandez cela à vos agents » — parce que, selon moi, ce sont ses employés. « Demandez-leur, parce que vous dîtes que ce sont les familles qui les apportent alors qu’ils sont fouillés de bas en haut. Qui a un accès libre ? »
Dans votre perspective, pourquoi les lettres des personnes privées de liberté n’arrivent-elles pas jusqu’à leur famille ? Cela dépend des personnes qui écrivent ?
Non, parce que tous les détenus savent plus ou moins ce qu’ils peuvent écrire, et la famille également. On leur écrit comment va la famille, ce que l’on fait. Je fais partie de celles qui écrivent surtout des déclarations d’amour, je suis romantique. Mon mari livre plutôt ses sentiments sur ce qui se passe là-bas, avec lui, mais il fait toujours très attention aux mots qu’il emploie. Je comprends plus ou moins ce qu’il écrit, mais il parle toujours de ce qui s’y passe, comment est son quotidien, comment il va. Mais, par exemple, il ne peut jamais écrire dans une lettre qu’il a été victime d’une agression, parce que s’il écrit cela, cette lettre ne sortira pas et il sera victime de représailles.
entrevue avec Raissa Mello, journaliste, militante du Front pour la Désincarcération du Parana
Quelle est votre relation avec la prison et avec le Front Pour la Désincarcération ?
Je suis une ex-détenue, j’ai été emprisonnée en 2010 et je suis sortie du régime fermé en 2012, en semi-liberté, je portais un bracelet électronique. J’ai retiré ce bracelet en 2014. J’ai connu le Front pour la Désincarcération en 2019, grâce aux réseaux sociaux.
D’abord, j’ai connu le Programme pour la Désincarcération. J’ai cherché des initiatives dans l’état de Parana et j’ai fini par tomber sur le Front. J’ai connu beaucoup de familles, mais peu de survivants de la prison. Pour moi, ça a été une très bonne chose de connaître le Front parce qu’avant, j’ai passé beaucoup de temps à vouloir oublier, être une nouvelle Raissa. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça.
Il reste une trace et j’avais une lacune. Comment j’allais expliquer certains moments de ma vie ? Parfois, je disais que j’avais fait un séjour linguistique, que j’avais été hospitalisée, en dépression… J’inventais de telles excuses. Mentir, c’est très difficile, parce qu’on doit se souvenir du mensonge ou parler d’autres choses. Beaucoup de choses me dérangeaient. Je pense qu’il est aussi important de raconter que j’ai étudié dans une université privée, à la PUC, avec un bracelet électronique. C’était quelque chose de différent, à la PUC.
Les gens vous regardaient-ils bizarrement ?
Oui, ils me regardaient différemment. J’ai eu deux professeurs qui ont fait une pétition pour ne pas me donner leur cours. Ça a été très douloureux, ils se sentaient en danger avec moi. Imaginez : une personne qui porte un bracelet électronique, qui, en première année à la PUC, et qui retournait à Piraquara, dormait en prison, entrait et sortait avec une escorte policière ; comment une telle personne peut-elle être dangereuse ? À l’époque, j’étais très mince, je marchais le dos courbé, je ne voulais pas qu’on me remarque, et même atteinte de dépression, avec une difficulté, en voulant mourir là-bas, on disait du mal de moi.
C’était une époque très difficile parce que je me sentais très coupable. J’avais eu le privilège d’être l’une des élues par le projet de la PUC, mais je connaissais beaucoup de femmes, qui, dans ma tête, le méritaient plus que moi. Je pensais : « Est-ce que je ne suis pas en train de prendre la place de quelqu’un d’autre ? Est-ce que je le mérite vraiment ? » Et en prison, c’est comme : « Si tu l’as fait, tu es coupable, tu es en train de payer et c’est encore trop peu. Tu dois dire merci parce que ça pourrait être pire ». C’était très difficile.
Aujourd’hui, je ris quand je repense au drame ; je me sentais coupable parce que je respirais trop, j’occupais trop d’air dans le monde. Et j’ai toujours eu cette toux, avant même d’entrer en prison, mais comme j’y ai eu la tuberculose, ça a empiré. Même si ça faisait partie de son travail, je pensais au gardien de prison debout devant la PUC, qui attendait que mon cours se termine, et je perturbais la vie de ce mec. Je me sentais vraiment comme étant un poids pour la société. À la PUC, ça se répétait souvent.
À l’époque, je ne connaissais que deux types de témoignages : le témoignage à l’église : « Mon Dieu, j’ai survécu et maintenant, je suis lumière, je suis une bonne personne et j’ai créé une ONG » ; et celui plein de révolte, de douleur. Je connaissais peu de femmes qui avait survécu à la prison, j’avais beaucoup d’amis hommes, qui parlaient de cette douleur, de la haine du système. Je ne dis pas que c’est juste, mais je ne m’identifiais à aucun des deux. Et là, au Front, grâce au Programme, par les points, j’ai été surprise : « Ma vie aurait dû être bien meilleure… C’est ça que je veux faire. » Et j’ai commencé à étudier la sécurité publique.
Comment sont les relations entre les personnes privées de liberté ? Dans l’atelier de femmes, beaucoup parlent que la relation d’affect qu’elles y ont trouvé. Une relation qu’elles n’ont eu ni dans leur vie, ni dans leur enfance. Une relation de sœurs. Mais également, bien sûr, il y a les disputes, les peurs, les haines.
Bon, pour moi ça été très difficile parce que je viens d’une famille dans laquelle j’ai eu tout cela. Donc, d’abord, il y a eu le moment de l’absence, par exemple, « Où est ma mère ? Où est ma grand-mère ? Où sont mes tantes ? À qui vais-je demander de l’aide ? ». J’avais en tête tous les stéréotypes possibles sur les femmes en prison, je me disais : « Mon Dieu, elles vont me tuer ». Mais j’ai été bien reçue, dans la mesure du possible, parce que bon, je suis arrivée renfermée, je pleurais toute la nuit et une femme est venue vers moi et m’a regardé : « Quel âge as-tu ma belle ? » , « J’ai 19 ans », « Et qu’est-ce que tu fais ici ? », « Je suis condamnée [dit-elle, en pleurant] ». J’avais peur de parler, parce que j’avais tous ces stéréotypes négatifs… Mon imaginaire de la prison venait des télénovelas, des films et des professeurs aussi qui nous menaçaient, « Ah, si tu échoues à ce test, tu finiras en prison ».
J’ai pleuré toute la nuit, puis, une femme de 58 ans est venue en disant qu’elle ne savait pas ce que j’avais fait, mais qu’ici, on avait déjà été jugée. Elle a dit « Si tu pleures tous les jours, ça va être plus difficile. Tu dois dormir parce que demain, ça ne sera pas facile ». On créé ainsi des relations. L’une des choses qui a été décisive, c’est que lorsque je suis arrivée à Piraquara II, j’avais 19 ans et dans les premières cellules que j’ai vues, les premières femmes que j’ai côtoyées étaient des femmes beaucoup plus âgées que moi, je pense qu’elles avaient 40 ou 50 ans. Ce n’est que la première fois que je suis sortie dans la cour que j’ai vu des femmes plus jeunes.
Mais je me disais toujours : « Mon Dieu, j’ai pris le mauvais chemin beaucoup trop jeune, parce qu’elles ont pris ce chemin plus tard ». Aujourd’hui, je parle de cela avec beaucoup d’humour parce que j’ai été suivie psychologiquement, j’ai été très entourée. Malgré cela, la relation était difficile aussi ; mais après, c’est devenu comme ça, par exemple, partager nos rêves de sortie, partager les choses, échanger sur nos expériences, parce qu’elles étaient des personnes avec des réalités différentes, des âges aussi, elles étaient déjà mères. D’ailleurs, j’ai beaucoup mieux compris ma mère en vivant avec d’autres mères, vous savez ? Par exemple, j’entendais souvent : « Tu as l’âge de ma fille ». Mon Dieu, j’ai aussi beaucoup entendu : « Tu ressembles physiquement à ma fille ».
Parce qu’elles s’attachent, imaginent, doivent te considérer comme leur propre fille.
Il y avait une femme, d’ailleurs, qui était emprisonnée depuis 20 ans et qui avait laissé une fille de 4 ans [hors de la prison]. C’est une des conversations qui m’a le plus marqué, elle disait : « Mais qu’est-ce que tu aimais faire ? », j’ai dit : « Je sortais avec mes amies, je buvais devant chez moi », « Quel type de musique tu aimes ? ». Elle imaginait comment était sa fille, vous savez ? Et donc, ses parents habitaient sur la côte, sa mère était très dure, du genre : « Je ne vais pas soumettre ton enfant aux visites, la faire grandir en voyant la prison ». Elle n’avait plus jamais vu sa fille depuis les 4 ans de la petite.
Mariana, c’était le nom de sa fille, et elle disait : « Elle avait les cheveux bouclés, comme toi, elle était matte de peau, comme toi », elle disait : « Ma fille aussi, elle parlait à tout le monde, elle ne s’arrêtait jamais de parler, comme toi ». Et c’était très triste, parce qu’après ma sortie, presque un an après, je suis allée à Paranaguá, j’ai cherché sa famille et je ne l’ai pas trouvée. J’ai beaucoup cherché parce que je voulais rencontrer Mariana et lui dire : « Regarde, ta mère a pensé à toi durant ces 20 dernières années. Ta mère tressait mes cheveux en prison pour que j’aie l’air propre et que je sois jolie ». Je voulais lui dire, je ne sais pas, d’écrire une carte ou, si elle ne s’y sentait pas prête, lui dire que sa mère avait été mère même en étant absente durant ces 20 dernières années. Mais je n’ai pas retrouvé la famille.
D’après votre expérience, comment l’incarcération affecte-t-elle la personne privée de liberté et, également, sa famille ? Dans le sens émotionnel, économique.
Je pense que de toutes ces façons… C’est un stigma, tant pour la personne, que pour sa famille…
Je pensais que je travaillerais pour toujours dans un centre commercial, ou dans un fast-food, et je devais entendre que j’avais eu de la chance parce qu’au moins, j’avais du travail. Nous sommes très fortement exploitées et on doit toujours remercier. C’est l’une des choses qui a été difficile pour moi.
Il y a eu une fois, aussi, où les personnes du milieu dans lequel je me trouvais savaient ce qui m’était arrivé. C’était des femmes d’un mouvement et nous étions dans un bar, en train d’organiser le 8 mars. Quand nous sommes sorties du bar, la voiture de l’une d’entre elles n’était plus là. Et elle m’a demandé si j’étais au courant de quelque chose.
Ensuite, elle a appelé la police, elle a déposé une plainte, mais elle me téléphonait et me demandait : « Tes amis ne sont au courant de rien ? » Et quand j’étais à l’université, la maison d’un ami a été cambriolée, et lui aussi me demandait où ses biens pourraient être vendus. Comme si je le savais, comme si j’étais la reine du crime…
Dans mes relations aussi. Il y a eu un garçon horrible… Il couchait à droite et à gauche, mais il était plus attentionné avec les autres filles. Je voulais qu’il m’accompagne à l’arrêt de bus et il me disait que ce n’était pas nécessaire. C’était comme s’il disait : « Ah, tu as déjà eu affaire à ça, tu n’as pas besoin, tu es forte ». Non, je mérite de l’affection…
En plus, il y a tout le fétiche de la douleur. Une fois, un mec m’a demandé, de façon très froide : « Tu as été violée en prison ? ». Non, je ne l’ai pas été, et si je l’avais été ? Il n’a eu aucune délicatesse. Il a eu de la chance parce que ce n’est pas une expérience que j’ai vécue. Et principalement, dans le milieu académique… J’ai eu le privilège d’être une ancienne détenue qui fréquente le milieu académique, mais je suis devenue un objet d’étude, d’une manière qui me faisait penser : « Mon Dieu, mais même à un animal, on ne lui fait pas ça. »
À partir de votre expérience, de votre trajectoire, que pensez-vous qui pourrait être changé dans le système carcéral aujourd’hui ?
Je pense que, tout d’abord : qu’est-ce qui mène à la privation de liberté ? Penser à cela allégerait déjà, d’une certaine manière, tout le système. Aujourd’hui, nous savons que les prisons sont pleines, principalement, de personnes qui ont commis des crimes contre le patrimoine. Et, lorsqu’une personne est détenue, il ne s’agit jamais seulement de la personne, il s’agit de toute une famille.
La progression de peine est difficile également ; les mesures pour la rééducation sont extrêmement difficiles. J’ai connu des mères qui sont entrées en prison enceintes, et la meilleure progression de peine possible, signifie sortir lorsque les enfants auront cinq ou six ans.
La vie des personnes qui se trouvent hors de la prison avec celles qui sont incarcérées, plus les projets et l’accessibilité… Pour que les personnes puissent vraiment voir que dans les prisons, les personnes sont complètement capables de contribuer aussi.
Penser au temps durant lequel les personnes sont enfermées, à ne rien faire, à, uniquement, cultiver leur douleur. Elles pourraient avoir accès, parce qu’un jour ou l’autre, ces personnes vont retourner vivre dans la société.
Penser au temps durant lequel les personnes sont enfermées, à ne rien faire, à, uniquement, cultiver leur douleur. Ces personnes vont retourner vivre dans la société.
Il y a une usine de ballons, ici… Les femmes reçoivent moins de la moitié du tiers du salaire minimum. C’est de l’exploitation, ce sont des personnes qui se tuent pour, lorsqu’elles sortiront, avoir de l’argent pour rentrer chez elle. Personne ne devient riche en prison.
Et c’est dans ces conditions que beaucoup reviennent, puisque sans projet, ces personnes sortent et n’ont aucune perspective de futur, après quelques mois, elles reviennent, n’est-ce pas ?
Oui, principalement parce que leur maison, leur routine, leur vie finit par être liée à cette institution. Quand je suis sortie, une femme m’a tenu la main et m’a dit : « Tout au long des années que tu as passées ici, j’ai vu que tu as une mère, mais si quelque chose se passe, sache que tu as une autre famille, ici, une autre maison ». Et ça, c’est très lourd, ce n’est pas beau.
J’ai été très préparée, surtout par les personnes les plus âgées qui se trouvent là-bas, à ne pas me faire d’illusion parce que, même en étant diplômée, les personnes qui sont passées par là ont tendance à revenir. Elles me préparaient : « On a vu une femme qui avait réussi à quitter le pays et qui au final est revenue ». C’est une peur que je ressens encore aujourd’hui.
Une autre chose : la nourriture est horrible. La nourriture sent mauvais.
Dans l’état de Parana, elle est préparée par une entreprise tertiaire. Des plats préparés arrivent, sans avoir le temps d’être réfrigérés, la nourriture devient verte — le riz vert de Piraquara. C’est un rite de passage : les personnes applaudissent pour que tu avales le riz vert pour la première fois.
Et je voulais dire aussi qu’il y a des petites luttes que nous devons célébrer, parce que vous avez beaucoup parlé d’éducation, de changements très importants, mais… Ah, il faut célébrer cela. Ces petits changements sont importants.
Je sais que c’est difficile, il y a la sécurité. Mais dans cet endroit, il n’y a pas de miroir, on finit par perdre l’image de soi, on veut se voir.
Les femmes sont infantilisées : parfois, des personnes viennent pour faire des ateliers de découpages et de collages avec nous, et pas dans le sens du collage, mais de l’expression. Les gardiens eux-mêmes, les personnes religieuses elles-mêmes, pensent parfois que nous sommes dans une crèche. Non, nous avons une histoire.
Les familles devraient aussi faire attention à ne pas juger. Il faut se rappeler que les femmes incarcérées sont plurielles : il y a des gens de toutes les couleurs, de tous les pays, de toutes les religions. Elles ne sont pas des objets d’études. Rappelez-leur qu’elles sont humaines parce que là-bas, tout est fait pour que cela s’oublie.

Layra Rodrigues | BRÉSIL |
Diplômée en sciences politiques et en sociologie, avec des recherches dans le domaine des relations sociales de genre, de race et de classe et des droits de l’homme. Elle est actuellement secrétaire d’école.
layrafab@gmail.com
Jhey Rodrigues | BRÉSIL |
Étudiant en médiation culturelle - arts et lettres à Unila. Elle est agitatrice culturelle à Foz do Iguaçú depuis 2019. Elle est l’une des créatrices du Slam de la Frontera et bénévole à la bibliothèque communautaire Cidade Nova Informa.

Lucas Duarte | BRÉSIL |

Márcia Tillmann | BRÉSIL |