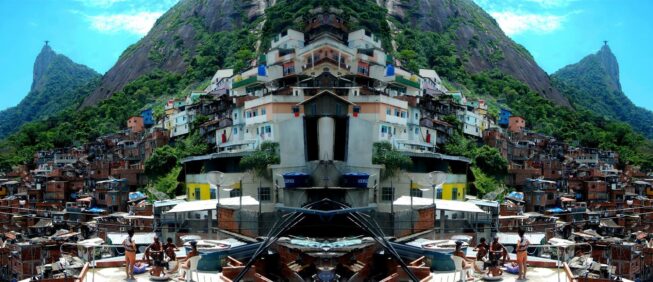Daniel Souza: entre amours et quilombos en Amazonie noire
L’un des principaux leaders de quilombos [communautés organisées d’esclaves] de l’état du Pará, Daniel revient sur la saga de ses ancêtres qui ont peuplé la région du Erepecuru et nous raconte comment ces vies ont aidé à peindre l’Amazonie en noir.
Raquel Paris
| Brésil |
13 de août de 2020
traduit par Déborah Spatz
Pour que cette histoire puisse être racontée, revenons 200 ans en arrière, plus précisément lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle, quand les premiers hommes, femmes et enfants d’origine bantu, venus principalement d’Angola et de l’actuelle République Démocratique du Congo furent amenés dans les fermes de bétails et de cacao dans l’État du Pará. Au beau milieu d’une immense forêt, des rivières si vastes qu’il était impossible de voir l’autre berge, et une vaste population locale, certains réussirent à échapper à la captivité esclavocrate, en naviguant sur les eaux profondes de la rivière Trombetas, un affluant du fleuve Amazone. Ils profitèrent de la protection des cascades et se cachèrent dans les forêts pendant près de 100 ans et n’en sortirent qu’à la signature de la Loi d’Or. Celle-ci est l’histoire de l’un de leurs descendants.
Filles et fils de Erepecuru
Ceux qui ont déjà navigué sur la rivière Trombetas, situé dans l’état du Pará, dans la région nord du Brésil, savent bien qu’on peut le diviser en deux parties. La première est composée d’eaux dangereuses, difficilement navigables, là où se trouvent les chutes d’eaux, plusieurs peuples originaires et une parfaite cachette pour ceux qui, à l’époque, fuyaient l’esclavage. La seconde partie est constituée d’eaux calmes et de « terre noire (révélant la présence d’anciens villages autochtones), aujourd’hui imprégnée par des communautés de quilombos, qui se sont construites tout au long du XIXe siècle. La zone est disputée par ces communautés, les entreprises de minerais et les organismes fédéraux de préservation environnementale - « a Reserva Biológica do Trombetas e Floresta Nacional Saracá-Taquera1 Comme nous en informe Eurípedes Funes, dans son article « Comunidades Mocambeiras do Trombetas ». » [ Réserve Biologique du Trombetas et Forêt Nationale Saracá-Taquera].
C’est dans ce lieu de disputes que nous allons trouver le territoire de quilombo de Erepecuru. Formé par 12 communautés, parmi elles le quilombo de Jauary, terre d’habitation de Daniel Souza, âgé aujourd’hui de 62 ans, qui a dédié 30 années à la lutte des quilombos dans l’état du Pará. On peut dire que Daniel a été planté là-bas par son arrière-grand-père Benedito Melo, qui a fui sa condition d’esclave avec trois autres familles. Et, c’est par là, par ce retournement cosmique dans la vie de ses ancêtres, qui atteint et définit les vivants également , que Daniel commence cette narrative:
« Ce quilombo existe depuis la fin du XVIIIe siècle, quand les peuples des quilombos ont fui l’esclavage et se sont cachés grâce aux cascades. Seules quatre familles ont fui et n’ont pas été poursuivies à cause de la Cascade de Chuvisco, qui les a sauvés. C'est une cascade très haute, en été, elle atteint 80 mètres de haut. Elle possède trois grandes chutes d’eau sur un seul lieu, un endroit fantastique. Ils se sont cachés et y sont restés. Aujourd’hui encore, les traces de notre site archéologique existent, quelque chose de très beau. Le quilombo, aujourd’hui, se situe en bas des cascades, sur la partie calme de la rivière, où il n’y a pas de cascade. Ils s’y installèrent à partir de 1901. En 1889, ils y étaient déjà venus et y ont commémoré la fin de l’esclavage, dans la cabane de pierre. Tu imagines, vivre pendant 100 ans dans la forêt ? ».
Et ils n’étaient pas seuls. Le 22 février 1873, le journal « Baixo Amazonas », de la ville de Santarém, rapporte la fuite constante des personnes esclavisées et l’évidence de la pensée esclavocrate, raciste présente dans la rédaction2Description issue de l’article « Comunidades Mocambeiras do Trombetas », de Eurípedes Funes. »:
Apesar da grande falta de braços no que lutam os agricultores do Amazonas, aumentado este mal em que a avultada emigração para os seringais do Alto Amazonas, ainda temos a lamentar as continuas fugas de escravos que diariamente, abandonam seus senhores para se homisearem nos quilombos do Trombetas, em Óbidos, e Curuá, em Alenquer. O número crescido de escravos que contem estes dois mocambos eleva-se, segundo bons cálculos, a mais de mil. Não encontramos outro meio de extinguir os quilombos, já que tem sido improficuo os meios empregados pelo governo, em suas expedições com o fim de bater os mocambeiro.
[Malgré l’important manque de bras contre lequel luttent les agriculteurs de l’Amazone, le mal de la grande émigration vers les plantations de l’Alto Amazonas augmente, nous devons également regretter les fuites incessantes des esclaves qui, quotidiennement, abandonnent leurs maîtres pour s’hommifier dans les quilombos de Trombetas, à Óbidos et Curuá, en Alenquer. Le nombre croissant d’esclaves se trouvant des ces deux mocambos [communautés d’esclaves] est estimé, selon de bons calculs, à plus de mille. Pas d’autre moyen pour éteindre les quilombos n’ont été trouvés, puisque ceux employés par le gouvernement, dans leurs expéditions pour mettre fin aux mocambeiros, furent infructueux.]Ces « expéditions pour combattre les mocambeiros » ont été le thème de la première conversation que Daniel a eu avec son grand-père, Ricardo Melo, à propos du temps de l’esclavage. À l’époque, il avait onze ans et il n’avait jamais entendu de telles choses: « je ne me rappelle pas du jour, c’était un samedi, si je me souviens bien, en janvier 1969. Je chassais avec mon grand-père, c’était la première fois où j’entendais parler d’esclavage! J’ai été très ému, mais il l’a été encore plus que moi. » se souvient-il.

« Nous sommes les grands vainqueurs. Nos ancêtres ont fui l’esclavage et ont résisté »
Daniel raconte que, durant cette partie de chasse, le grand-père avait oublié le terçado (un grand couteau) dans la forêt. En arrivant à la maison, alors qu’ils cassaient les noix, Ricardo s’est souvenu du terçado et c’est ça qui l’a fait pensé aux souvenirs de l’esclavage: « Je viens de me souvenir de l’esclavage. Quand nos grands-parents ont fui ici, ils perdaient des choses et ne retournaient pas les chercher. Ils allaient dans la forêt pour se cacher plus loin et ne revenaient pas pour reprendre ce qu’ils avaient oublié », a raconté Ricardo. Tout de suite, le grand-père a demandé à ce que la conversation reste secrète et celle-ci ne seraient répétée que des décennies plus tard.
Celle-ci n’était pas l’unique stratégie pour éviter les commandeurs des maîtres et pour qu’ils puissent continuer leur fuite. Pour être certains de ne pas revenir, les ancêtres de Daniel ont stratégiquement construit le quilombo sur un territoire élevé et se maintenaient aux aguets pour mettre le plan de fuite en action, quand la menace surgissait.
« Ils ont apporté d’Afrique le pouvoir de guérison, ce pouvoir de voir les choses invisibles, de savoir ce qui pouvait arriver. Ils ont été entraînés de cette façon: Guilherme, le frère de mon arrière-grand-père était entraîné à ramer énormément, pour que quand quelqu’un arrive pour les poursuivre, ils puissent partir rapidement. Les lieux se situaient à des points stratégiques pour parvenir à voir de loin. Donc, il y avait cette personne qui ramait beaucoup; il y en avait un autre qui entendait bien, de loin il disait si quelqu’un arrivait; il y en avait un autre qui sentait les odeurs, il avait un excellent odorat, il était entraîné à sentir l’odeur du feu. Ces entraînements se sont beaucoup produits entre eux. Ils travaillaient beaucoup, ils s’interrogeaient sur qui pourraient venir pour les ramener à l’esclavage, et c’est ce qui est s’est passé, en principe », explique-t-il.
« À cette époque, les noirs restaient presque cent ans dans la forêt. Comment se soignaient-ils ? Ils ont appris avec les indiens »
Mais ce ne sont pas seulement les habiletés apprises lors de l’entraînement du quilombo et celles rapportées de leurs vies pré-esclavage qui ont maintenu ces personnes en vie. Durant toute l’histoire coloniale, nous voyons une clé importante qui se répète: l’alliance entre les peuples autochtones d’Abya Yala (l’actuelle Amérique) et ceux amenés de force du continuent africain. L'habileté de reconnaître les plantes médicinales a été l’une des habiletés échangées. En tant que maître du territoire, les peuples autochtones ont offert une carte des rivières, des ruisseaux, des cascades et des chemins sûrs au milieu de la forêt. Ces rencontres n’étaient pas toujours simples et pas amicales, cependant, l’alliance a été déterminante pour la réussite de la fuite et plus encore, pour la permanence et la longévité des quilombos.

Principes et éducation quilombola
Les traces de l’esclavage ont parcouru plusieurs générations et sont arrivées jusqu’à l’enfance de Daniel. C’était très commun entre les enfants, de se cacher dans la forêt lorsqu’ils entendaient le bruit d’un moteur, ou alors que les mères leur disent qu’un inconnu arrivait, afin de mettre fin aux jeux. Mais, selon lui, rien de cela n’était plus important que la joie de naître dans un quilombo. C’était une joie traversée de façon permanente par l’abondance de la chasse, des aliments et de l’affection. Cette auto-suffisance a permis, par exemple, à Daniel de ne pas aller dans la ville d’Oriximiná, pendant dix ans.
« Comme la vie au quilombo était belle ! L’union, l’amour, la solidarité fonctionnait vraiment ! Le respect des plus âgés, demander la bénédiction des plus vieux. Être quilombola, ce n’est pas seulement le dire, tu dois également le montrer à travers les principes. » Et pour Daniel, l’éducation crée les conditions pour le maintien des principes de son peuple, mais il nous prévient: ce n’est pas n’importe quelle éducation ! Il insiste sur une éducation qui vient de « chez soi », qui enseigne l’amour, la solidarité, le respect de la nature et la fierté de son histoire.
« L’histoire qui nous a été racontée par les livres à l’époque est une histoire complètement différente. Aujourd’hui nous construisons une nouvelle histoire, nous l’amenons dans les écoles, pour que l’on puisse comprendre notre vraie histoire. Comment ça s’est passé, pourquoi nous avons fui, pourquoi nous nous sommes cachés. Personne n’aime être esclave ».
Il continue en mettant en avant un autre aspect de l’éducation: la construction de la mémoire sociale de son peuple. Les circuits de mémoires qui se sont initiés avant l’esclavage constituent un ensemble d’informations qui connectent le passé et le présent de sa communauté. Ils renforcent et agrandissent l’identité et les liens d’appartenance à soi-même, avec l’autre et avec son territoire. La mémoire quilombola appartient, donc, à tous et n’appartient à personne3Voir Pierre Nora, 1993.. Les plus jeunes apprennent avec les plus âgés et, ainsi, ces circuits sont constamment revécus et rétro-alimentés: « mon grand-père, par exemple, a été mon professeur; ma tante est morte à 92 ans; ma mère qui en a 83 a une histoire à nous raconter et c’est seulement une vraie histoire ».
« Le quilombo, pour nous, dans le passé et aujourd’hui, est une école »
« Vraie » histoire et histoire « racontée » sont un binôme qui apparaît de manière récurrente dans son discours. Daniel souligne constamment la différence entre la vraie histoire - racontée par les ancêtres et l’histoire « racontée » - que l’on trouve dans les livres officiels. Pour lui qui n’est jamais allé à l'école et qui a eu sa mère comme professeure, utiliser ces catégories légitime sa narration devant son groupe et les autres visiteurs qui apparaissent sur le territoire. « À cette époque-là, notre histoire était racontée d’une manière très triste, en nous traitant comme si nous n’étions pas des humains. Je me souviens quand j’ai commencé, en 1969, à étudier le livre qui s’appelait « Enfance Brésilienne », j’ai lu ce livre. Les noirs travaillaient comme esclaves et cela était dit de manière très normale, vous comprenez ? Pour eux, c’était quelque chose de très simple et aujourd’hui, nous reconstruisons une nouvelle histoire, c’est très important dans ce contexte politique actuel au Brésil et nous racontons notre vraie histoire », conclue-t-il.
Le passage du temps nous a apporté beaucoup de complexités pour le maintien de l’éducation quilombola et ses principes. Pour lui, les aspects apportés par la contemporanéité doivent être considérés mais « sans oublier ce beau passé que nous avions, plein d’union et d’amour », déclare Daniel. Enfin de compte, c’était grâce au renforcement de la collectivité que l’organisation politique du territoire a été conquise.
Préservation de la forêt et auto-organisation: un héritage quilombola
Aujourd’hui, l’auto-organisation du quilombo Erepecuru se fait grâce à l’association des habitants qui regroupe un ou deux représentants de chacune des 12 communautés du territoire quilombola d’Erepecuru. Et les défis sont nombreux: les bûcherons, les mines d’or illégales, les projets gouvernementaux hydroélectriques, la gestion de la forêt sans consulter les peuples quilombolas. Cependant, la résistance et la mobilisation font partie de l’histoire des quilombolas d’Erepecuru et compte comme victoire récente, la reconnaissance collective de leurs terres, l’une des premières de ce modèle au Brésil.
« L’une des manières de réunir le peuple, c’est l’association. Le plus important, pour nous, c’est qu’elle s’organise pour l’autonomie des communautés et qu’on ne reste pas dans cette dépendance. On a une connexion à internet collective, et ça, c’est une chose importante, c’est un collectif que notre communauté a et elle est la seule à avoir cela. »
Un autre aspect déterminant dans l’organisation socio-politique du quilombo de Jauary, c’est la préservation de la forêt. Pour cela, les ancêtres de Daniel ont développé une stratégie ingénieuse, perpétuée jusqu’aujourd’hui par les descendants: le baptême des plantations d’oléagineux avec les noms des ancêtres. « Il y a un champ qui porte le nom de mon père Francisco Melo; il y a celui de Lautério, qui était mon arrière-arrière-grand-père; il y a la plantation de mon grand-père, qui s’appelait Ricardo Melo; là haut, il y a mon arrière-grand-mère qui s’appelait Senhorinha, il y a aussi un champ avec son nom, celui de mon oncle, du cousin de mon père, un champ avec son nom, l’oncle Modesto. Il y a donc plusieurs choses qui ont existé dans le passé et qui restent dans cette mémoire sociale pour nous. »
La préservation de la forêt est accompagnée de certaines leçons d’auto-organisations indispensables, comme préparer la terre « dans la limite de la consommation », montrant l’adéquation sophistiquée entre la sécurité alimentaire et la protection de la forêt, que les quilombolas ont développé: « À l’époque, nous ne travaillions que de manière collective, nous faisions des puxirum (des actions communes), comme on les appelle, et le travail était toujours divisé entre les terres préparées pour la culture, proches les unes des autres. L’union des plus vieux était plus forte », décrit-il.
Parce qu’il sait lire, écrire, qu’il possède une large action politique, Daniel est l’un des principaux leaders du territoire. On peut retrouver plusieurs articles, images et vidéos qui montre l’importance de la lutte pour les droits des peuples quilombolas, en Amazonie. Une trajectoire merveilleuse qui sera bientôt transformée en livre.
« Être quilombola ce n’est pas seulement dire qu’on est quilombola et ensuite, après avoir reçu son diplôme universitaire, tout oublier, principalement les principes qui sont le respect, la collectivité, l’amour, la solidarité. Ça, ce sont les principes du quilombo qui ne doivent jamais être oubliés, même s’ils ne fonctionnent qu’à l’intérieur du territoire, mais ce sont des choses très importantes pour qu’aujourd’hui, on préserve notre identité. C’est le truc de l’identité quilombola: garder les principes de respect »
.