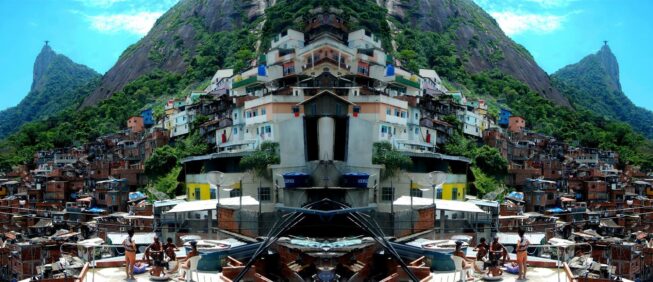Porte de non-retour
Natasha Omokhodion-Kalulu Banda
| Zambie |
18 de août de 2020
traduit par Déborah Spatz
Elle fredonne. Les vibrations de sa voix retentissent contre le mur de la chambre, laissant place à un nouveau soleil. La pénombre sur le mur révèle des meubles familiers alors que la lumière bleue remplit doucement la chambre. Son esprit rejoint l’âme au plus profond de son être — les faisant flotter comme s’ils ne formaient qu’un — incertains de leur avenir après ce jour.
Une main finement gantée de peau tamponne de l’intérieur, contre les murs intérieurs de son ventre de velours noir. Des rayures courent sur le monticule sombre, chacune d’entre elles racontant une histoire de celui à qui elles appartiennent. Elle sent le bébé bouger violemment, la faisant poser sa main au même endroit où se trouve l’autre petite main.
— Va dormir, 19 !, dit-elle.
— Je ne peux pas, répondit-il.
— Tu vas nous faire avoir des problèmes ! Tu dois être prêt et bien reposé pour aujourd’hui.
— Mais je ne veux pas y aller.
— J’ai bien peur que tu le doives. C’est le cycle de la vie.
— Raconte-moi l’histoire encore une fois.
— Laquelle ?
—S’il te plaît, raconte-moi l’histoire, M.
Elle lève les yeux vers le plafond stérile. Sa froideur chromée renvoie le regard. Ses yeux se ferment et elle grogne. Son ventre se contracte en une boule serrée. Elle respire rapidement, de manière courte, jusqu’à ce qu’elle se détende à nouveau. Elle fait ce que sa première accoucheuse lui avait dit de faire. Pour vaincre la douleur, elle commence par raconter le conte. Elle parle de la façon dont elle a parlé à tous ceux qui étaient présents avant 19. Par son esprit.
— Tout a commencé il y a quelques années — quand les murmures de l’occident ont commencé. Des murmures de scandales se sont répandus comme les feux de brousse à travers le pays — des histoires de bébés Enugu fabriqués et vendus dans des usines. Le monde avait tellement changé pendant l’ère de la transformation que la commodité et l’immédiate gratification ont nourri un démon vivant et voluptueux qui n’a fait que consommé et détruire. D’un simple glissement sur l’écran, les personnes achetaient et vendaient des enfants. Les femmes pauvres, n’ayant que leur fertilité à vendre, avaient commencé à émigrer.
Au Nord, mon peuple a fait de longs et pénibles voyages à travers les forêts, les montagnes et les vastes zones sans eau pour s’échapper vers l’Europe. Les bêtes et le mauvais temps les dévoraient, si la faim ne les battait pas. Après l’extrême difficulté du périple à travers le pays, ils sautillaient sur la grande mer bleue — à vingt dans un tout petit bateau gonflable. Vomissant les uns sur les autres, déféquant à la vue du ciel. Combattants et craintifs, sans capitaine pour les guider. Beaucoup se seraient perdus dans les tombes d’eau et de sel.
Des personnes aux yeux désespérés devant les télévisions ont donné l’alerte. Des voix factuelles à la radio ont rapporté les faits, mais personne n’a rien fait. Les gens ont été échangé comme des esclaves au large des côtes libyennes, des siècles après l’abolition de la traite des esclaves. Dans le sud, le continuent a souffert.
Des médecins, des ingénieurs ainsi que des professeurs sont partis vers de plus verts pâturages jusqu’à ce qu’il n’en reste plus un à la maison. Notre population a augmenté férocement, mais nos industries ont souffert. Nos systèmes hydriques sont devenus troubles à cause des déchets synthétiques qui ne se dissoudront jamais. Nous gouvernement était corrompus. Certains empruntaient jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus rembourser. Tout cela a continué à nous tourmenter jusqu’à ce que des nuages noires commencent à visiter notre continent…
— Et ensuite quoi ?
— Mais nous avons déjà entendu cette histoire, 19.
— Oui, mais tu ne la finis jamais, M.
— Les chinois avait déjà établis de forts liens en Afrique, en construisant des chemins de fer pour nous, des gratte—ciels, des écoles et des hôpitaux. Ils ont appris nos langues et sont devenus nos frères. Ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’ils ne se présentent et proposent une manière de résoudre nos problèmes de migration et d’endettement.
— Que nous ont-ils promis, M ?
— Ils ont proposé de créer un grand programme conjoint de fertilité à condition que nous formions un État panafricain, qui allait devenir la Nation Unie de Mbiguli.
— Mbiguli ?
— Oui. Ensemble, nous avons créé une race de super—soldats, les Akahn — fait à partir d’une sélection rigoureuse. La nouvelle croissance économique et l’allégeance de Mbiguli à la Chine ont changé l’ordre mondial. Les dirigeants occidentaux n’aimaient pas ça. Pour la première fois dans l’histoire moderne, les Africains menaient le monde. Le commerce mondial été affecté. Nos médecins et nos professeurs sont revenus et nous sommes devenus de plus en plus auto—suffisants. Ayant perdu l’accès aux ressources provenant de Mbiguli, l’Occident a décidé de nous déclarer la guerre. Mais, ça n’a pas duré longtemps parce que…
— Parce que quoi, M ?
— Nous…
— Nous, quoi, M ?
— Au milieu de leur nuit la plus froide et pendant notre journée la plus chaude, nous avons largués des bombes silencieuses et invisibles sur leurs continents. Quelque chose d’ignoble et d’irrévocable.
— En sont-ils morts ?
— Pas vraiment, 19…
— Que s’est-il passé, alors, M ?
— Je ne sais pas, 19.
Christopher regarde sa femme, Kate. Ses cheveux roux sont collés à son front de porcelaine, ses joues rougies par le soleil de la basse savane. Des perles de sueur naissent le long de son nez parfait. De hautes herbes dorées se plient sous le vent, se penchant vers la gauche, puis vers la droite, comme si elles étaient en transe. Les acacias et les jacarandas, robustes, épineux mais sûr d’eux, camouflent les quelques antilopes qu’il peut voir.
Elle tord sa main aux jointures pâles. Il prend ses mains entre les siennes. Le rabat en toile du Land Rover frappe contre les côtés de la camionnette en plein air. L’idée d’un véhicule fonctionnant au diesel semblait nostalgique dans les histoires racontées par son agent virtuel, mais pas tellement dans la vraie vie.
Un groupe de grands zèbres apparait derrière les arbres, galopent parallèlement à leur voiture, faisant vibrer la terre, soulevant la poussière de leurs sabots. Christopher entoure les épaules de sa femme de son bras protecteur. Le chauffeur Mbiguli, habillé de façon élégante, sourit avec fierté tout en expliquant qu’ils sont tous en sécurité. Aucun animal de peut les approcher, grâce à l’infrastructure InvisiWallTM — C’est impossible », dit-il, renforçant le « p » avec un accent révélant sa provenance d’un pays lusophone.
Sa voix porte au-dessus du vent et il raconte l’histoire de sa partie de Mbiguli. « Anciennement divisé entre la Zambie, la Tanzanie et la République Démocratique du Congo, ce détroit se trouve sur ce qu’on appelait le lac Tanganyika. C’est la capitale touristique de la région. La Zambie a une station balnéaire sur la baie de Kaaba, qui a été construite par son président dans les années 1980. Avec des plages si pures, la nouvelle Nation de Mbiguli a décidé d’étendre cette merveilleuse attraction en créant un détroit qui s’étant à partir de l’Océan Indien, sur les côtes de la Tanzanie.
Ils avancent, laissant derrière eux la savane. Des pelouses très bien coupées sont les précurseurs de l’entrée tropicale et verdoyante. Des gerbes de plantes grasses forment d’impressionnantes fontaines à feuilles. Le couple cambre leurs cous en arrière pour voir à quelle hauteur ces derniers montent, s’attendant presque à ce que Goliath passe à travers les sections de palmiers. Des oiseaux gazouillants volent entre les arbres, conscients des nouveaux arrivants. Le véhicule passe par l’ouverture du portail en bois, et sur un pont de galets blancs suspendu dans les airs, accroché à des bougainvilliers fuchsia et orange. De grands gardiens à la poitrines large, les Akahn, postés de chaque côté du ponts, leurs cheveux noirs de jais attachés en queue de cheval fluide. Ils regardent vers le sol, suivant de leurs yeux la voiture en mouvement. De petits frissons traversent l’avant-bras de Christopher alors que la main humide de Kate se mêle à la sienne.
Le pont s’étend sur une des centaines de mètres, sur une mer blanche. D’énormes paons, les ailes déployées en éventail les accueillent au bout du tunnel floral. Christopher boit, avec difficulté un gorgée d’eau de sa bouteille. Il remarque que les étroites épaules de Kate sont toujours tendues.
L’hôtel est opulent, avec de hauts chalets suspendus contre le ciel bleu. De géants baobabs abritent des restaurants à différents niveaux. Avec des ascenseurs qui montent et descendent au centre, ainsi que de gauche à droite le long de leurs branches, comme un système nerveux central.
Dans le haut central du rez-de-chaussée, ils sont accueillis par des souffles d’air froid et des notes enjouées de jazz africain millénaire. Des hôtes holographiques vêtus de toges de cobalt les accueillent s’inclinant jusqu’aux genoux, rappelant une hospitalité qu’on ne trouve que dans les films historiques. L’Amarula est servie sur de la glace, accompagnée d’un éventail de plats : des graines de courges grillées, du chikanda, de la banane plantain, des côtes d’impala fumées, des tranches de pastèque et de mangue. Des serviettes refroidies au nitro sont fournies par des robots ovales à roulettes. Christopher et Kate apprécient la sensation des flanelles à l’arrière de leurs cous. Les compositions florales symétriquement alignées éclatantes de couleurs font soupirer profondément le couple. Ils ne sentent aucune odeur.
Une fois rafraîchis, des porteurs arrivent pour les aider avec leurs bagages.
Ils montent dans leur chambre à travers les tubes de baobabs. Le trajet est délibérément lent, leur permettant de profiter de la beauté du détroit. L’eau couleur de saphir en—dessous fait danser les rayons du soleil, frappent le blanc pur de la plage. Ils arrivent à l’étage Makumbi, et le tunnel les amène à gauche vers leur chambre. Des couloirs transparents au niveau des nuages surprennent le couple, mais ils sont rassurés par les flèches en néon indigo le long du sol.
Alors qu’ils s’approchent de leur chambre, les femmes de chambres se précipitent hors de leur vue. Christopher sort ses jumelles, étonnés de penser qu’ici était autrefois un pays sans accès à la mer. À travers ses lentilles, les magnifiques îles qui parsèment la baie sont plus proches. La faune et la flore exotiques sont chacune abondantes, imaginées pour créer un écosystème unique — offrant un éventail pour les invités.
Une girafe génétiquement modifiée les accueille à leur balcon. Son œil droit regarde curieusement le couple, remplissant la majeure partie de la fenêtre. Elle mâche de la verdure en faisant de larges mouvements circulaires, respirant lourdement dans leur direction. Sa femme se dirige vers l’animal comme aimantée et souri. Pendant un instant, Christopher ressent qu’il a enfin son accord.
Une clôture virtuelle s’allume — donnant un avertissement — lui signalant de reculer. Un aigle pêcheur piaille trois fois et ils se retournent pour faire face à l’hologramme aux bords lisses qui apparaît au centre de leur chambre.
— Monsieur et Madame Hanover. Bienvenue dans le grrrrrand pays de Mbiguli! — Il écarte ses bras pour montrer sa taille. Il s’inline très fortement.
—Merci , répond Christopher.
— Bienvenue dans le Détroit, poursuit—il sur un ton de baryton profond, fondé en 2030 par le Conseil du Ministère du Tourisme. Vous avez été placé à l’étage le plus prestigieux — le Makumbi, du nom des magnifiques nuages au sein desquels il se trouve. Nous vous emmenons aussi près du ciel que nous le croyons. » Il fait un clin d’oeil, riant de sa propre blague. Kate reste silencieuse.
— Merci, Monsieur , dit Christopher au nom de sa femme.
— Appelez-moi Monsieur Bwalya.
— Merci… erhl… Monsieur Bwalya. Combien de temps pensez-vous que nous avons avant…?
— Oh, ne vous inquiétez pas, Monsieur. Selon notre lecteur d’IA obstétrique, votre porteuse présente tous les signes optimaux pour une livraison dans les prochaines 24 heures.
— Va—t—elle… se souv…?
— Non, Monsieur Hanovre. Nos porteuses n’ont ni conflits internes, ni sentiments de doute ou de séparation. Nous prenons des mesures prudentes pour nous assurer qu’elles n’aient pas non plus de souvenir de la grossesse. Une série d’ondes électromagnétiques s’en occupe dès la libération de l’enfant. En fait, votre porteuse personnelle est l’une de nos meilleures.
De l’autre côté du domaine, dans un bungalow blanc du Cap néerlandais, une âme fait son entrée dans le monde. La poitrine de Malaika se soulève. L’attrape—âme, un médecin sans bouche avec une blouse rouge et noire, se tient au bout de son lit. Il met ses doigts entre ses cuisses, l’incitant à pousser. Ses poings se serrent. De fortes explosions s’échappent de bouches. Ses dents grincent les unes contre les autres.
Elle ressent l’anneau de feu familier à la base de son anatomie. Elle est en train d’accoucher, le haut de la tête du bébé est en train de pousser. Elle émet un dernier grognement animal et il glisse, dans une précipitation mouvementée. Le flot soyeux et chaud coule. Une routine qu’elle connaît si bien. Une autre poussée et avec le dernier lui, le dernier morceau de chair et les vaisseaux qui reliaient le bébé à elle pendant neuf mois sont expulsés. C’est fait. Sa dernière âme est sortie.
Son comportement est angélique, mais son cri est tortueux. Malaika tourne sa tête et ferme ses yeux. Épuisée, elle tente d’ignorer les gémissements de l’enfant. Elle se demande ce que ça ferait d’avoir sa peau mouillée contre sa poitrine. De sentir son cœur battre contre le sien. De sentir sa tête coiffée de blanc. Ses seins réagissent à son cri, commençant à enfler.
L’attrape—âme vérifie les membres du bébé, ses doigts et ses parties génitales. Le sexe est le seul facteur prédéterminé par les Âmes elles-mêmes. Malaika cherche la satisfaction dans les yeux de l’attrape-âme, mais ils clignent vers elles. Confié à l’infirmière en chef, 19 est emmené, comme toujours, par la porte de non retour. Elle sait qu’elle ne verra plus jamais la blancheur de la peau du bébé contre la netteté de sa tête de carotte.
Les émotions la plonge dans un vortex de mémoires. Son esprit se souvient d’une journée au marché, où elle riait avec sa sœur, chantant des comptines dans la poussière rouge de Serenke. Elle se prépare à oublier alors que l’attrape—âme et l’infirmière en chef sortent de la salle d’accouchement. La lumière ultraviolette pulse à travers elle en deux flashs, puis elle s’évanouit. Pour la dix-neuvième fois.
Maila prend vit. Elle est de retour dans sa chambre. Propre, habillée et même le corps enduit d’huile. Elle se prépare à ne pas se souvenir. Mais d’une certaine manière, elle s’en souvient.
Quelqu’un frappe des mains sur le marché d’Elida. Un mélange de fumée de charbon malasha et de poisson séché qui bout. Des mirages qui fondent sur les toits de tôle. La scène ressemble à un écran de fumée bleue, comme le filtre de photo instantanées sur l’iPhone de papa.
Papa. Immense, aux épaules larges, la couleur de minuit. L’odeur de la mer traînant toujours derrière lui. Des tissus et des épices tombant de son sac plastique. Des intonations étrangères recouvrant son anglais francophone cassé. Ses contes d’une terre lointaine, de portes de non retour, se déroulaient chaque soir après son passage sur son tapis de prière tissé à la main. Ses semelles craquelées regardant vers le ciel, son visage en ferveur vers le bas. La raison pour laquelle elle était différente.
Elle se souvient.
Les sons cacophoniques de la kalindula et de la musique hip-hop retentissent des étales multicolores. Des femmes sur des tabourets sculptés en bois tressent des cheveux épais. Leurs fidèles clients sur des nattes de roseau, avec des bébés aux coudes cendrés, mangeant des goyaves. Des casseroles d’huile bouillante prêtes à transformer le contenu des plats en plastique vert et blanc. De grosses saucisses hongroises exposées, des empruntes sur leur emballage, couvertes de mouches noires, aussi affamées que des humains.
Elle se souvient.
Un vélo avec un large meuble de télévision attaché avec une corde en caoutchouc fait un écart. Une femme à moto habillée de façon extravagante avec des vêtements traditionnels pour un mariage arrive à toute vitesse dans la direction opposée. La peau de la femme est cendrée de poudre de talc et ses sourcils sont dessinés comme des virgules Nike à l’envers. Sa perruque se trouve anormalement au centre de son front. Malaika se souvient — elle rit de ce spectacle avec Edina. Papa est en chemin vers elles. Il est extraordinairement grand dans son agbada blanche.
Comme les sauterelles dans la Bible de Mama, une ombre dans le ciel se dirige vers eux. Un vent doux annonce son arrivée. Tout le monde se fige, comme les personnages dans les livres d’images. Les nuages sombre se dissipent dans de minuscules drones. Les machines à insectes arrivent vers eux. Une pour elle, une autre pour Edina. Ils planent bas et de manière stable. Un scanner rouge suit. Il va de haut en bas sur son corps — s’arrêtant sur son ventre. Ensuite, une lumière verte s’allume. Les calculs avec des caractères étranges sont faits en plein vol. Son visage est capturé, tout comme elle.
Une chaîne de voix provient de son ventre. Interrogeant, pleurant, riant, elle peut toutes les entendre, les Âmes qu’elle a libérées. Des questions des anciens locataires qui affirment avoir demeuré en elle, pour qui elle a déjà perçu leur prix.
Elle s’assoit et pose son pied sur le sol froid. Les mains sur la tête, elle essaie d’arrêter les voix, mais elles constellent dans son torse, et une lumière brillante émane de son cœur. Elle n’est plus consciente de son environnement parce que ne fait plus qu’un avec la force provenant d’elle.
Elle se dirige vers la porte et elles lui ordonnent de l’ouvrir. Porte après porte, elles se déverrouillent l’une après l’autre, alors qu’elle avance dans le couloir. Des douzaines de femmes sortent de leur chambre, toutes en transe. Leur uniforme, une robe de maternité et leurs chaussettes blanches les fronts ressemblés à des prisonnières. Les voix de leur ventre se joignent à celles de Malaika. Dans le caveau, les Akahn se crient dessus — leur voix aiguës sont en panique parce qu’ils n’ont pas été formés à prendre des mesures sur ces atouts. Les femmes possédées, continuent d’avancer.
Malaika fait irruption dans la chambre forte et trouve le tableau de commande. Le visage de Monsieur Bwalya, programmé pour être chaleureux et accueillant, apparaît, lui donnant un avertissement souriant. Elle trouve un cadrant qui déforme son image suppliant — grand, petit, étiré — jusqu’à ce qu’il tourne en spiral comme de l’eau dans un égout et finalement dans le néant. Elle manipule le tableau de commande comme si elle l’avait connu toute sa vie.
Des lumières rouges et des alarmes hurlent dans tout l’hôtel. La terre tremble et des sons tonitruants suivent. Incrédules, les Akahn désorientés regarde les moniteurs de jeu, qui font clignoter des animaux colossaux en direction des lieux sécurisés — écrasant les mini—bus de voyage et les touristes en mouvements. Leur attention est saisie par le son des trompettes.
C’est un mariage de singes, du soleil et de la pluie en même temps, qui se passe sur le domaine à chaque fois qu’un enfant naît. L’horizon chaud orange laisse entre des rayons d’espoir. Christopher regarde Kate, sa femme. Une naissance, l’élixir de vie. Il casse ses cheveux roux.
19 est amené dans la pièce. Si parfait. Si pâle.
Christopher, tremblant, reçoit le bébé. Son bébé. Une lueur chaude remplit son corps et illumine son visage. Kate se tient en face de lui, ses pieds nus plantés sur le sol de marbre. Ses bras se replient en une enveloppe sur sa poitrine. L’appel de l’aigle pêcheur dévie leur attention vers le centre de la pièce.
Un hologramme apparaît encore une fois. À leur surprise, l’image d’une grande femme étonnamment noire remplit la pièce. Son énergie est si forte que l’enfant de Christopher se retord dans ses bras. Son instinct lui dit d’appeler la sécurité, mais sa conscience lui dit de ne pas le faire. Le bébé commence à pleurer, son visage se transformant en une pâte à modeler écarlate.
La silhouette plane, instable et clignotante de manière fixe. Plus de silhouette apparaissent derrière elle. Des femmes de toutes les formes et de toutes les taillent, le ventre rond, vêtues des mêmes vêtements. Elles regardent fixement le bébé dans ses bras. Malaika lève les yeux du petits paquets qui se tortillent et les braque sur Christopher.
— 19, mon enfant, reste calme.
Silence.

Natasha Omokhodion-Kalulu Banda | Zambie |
Natasha Omokhodion-Kalulu Banda est zambienne, d’origine nigériane et jamaïcaine, vivant à Lusaka. Elle est mariée et a trois enfants. Natasha est passionnée par la scène littéraire croissante en Afrique et apprécie le pouvoir de la narration. Elle a été publié dans l’anthologie « Different Shades of Féminine Mind, The Budding Writer antology by Zambia Women Writers » de la publication en ligne de l’Association African Women Writers (Afriwowri) (2017) et a été mise en avant sur AfricainWriter.com pour son histoire « To Hair is Human, To Forgive is Design » (2018). Elle a été publiée dans Short Story Day Africa — Hotel Africa (2018) et le manuscrit de son roman récemment publié « No be From Hia » a été sélectionnée en tant que finaliste du prix Graywolf Africa 2019.